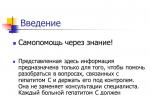Présentation sur le thème "hépatite virale". Hépatite virale Prévenir la transmission du virus
Complété par les étudiants gr. L-608V :
Semionova S.I. Fazylova S.T. Imankoulova A.R. Sagitova Z.Z.
Diapositive 2
L'hépatite virale est un groupe de maladies causées par des virus hépatotropes,
caractérisé par des lésions hépatiques prédominantes avec développement d'un syndrome toxique général, d'une hépatosplénomégalie, d'un dysfonctionnement et de l'apparition d'un ictère.
Diapositive 3
Structure du foie
Diapositive 4
Classification étiotropique de l'hépatite
1. Hépatite infectieuse (virale) :
Hépatite entérale :
- Hépatite A
- Hépatite E
Hépatite parentérale :
- Hépatite B
- Hépatite C
- Hépatite D
- Hépatite F
- Hépatite G
Hépatite en tant que composante de : fièvre jaune, infection à cytomégalovirus, rubéole, oreillons, infection par le virus d'Epstein-Barr, diverses infections herpétiques, fièvre de Lassa, SIDA.
Hépatite bactérienne : avec leptospirose, syphilis.
2. Hépatite toxique
3. Hépatite radiologique (composante du mal des rayons)
4. Hépatite due à des maladies auto-immunes
Diapositive 5
Hépatite virale A, E (hépatite entérique)
Diapositive 6
Diapositive 7
Riz. 1 Particules du virus de l’hépatite A
Diapositive 8
Riz. 2 Virus de l'hépatite E
Diapositive 9
Diapositive 10
Diapositive 11
Diapositive 12
Diapositive 13
Diapositive 14
Diapositive 15
Diapositive 16
Hépatite virale chronique (hépatite parentérale)
L'hépatite virale chronique (HVC) est une inflammation chronique du foie provoquée par des virus hépatotropes, qui dure sans tendance à s'améliorer pendant au moins 6 mois. La grande majorité des cas d'hépatite chronique sont provoqués par les virus de l'hépatite B, C et D. Le rôle des autres virus hépatotropes (F, G, TTV, SEN, etc.) est discutable.
Diapositive 17
Classification de l'hépatite chronique (adoptée au Congrès international des gastro-entérologues
à Los Angeles en 1994)
Diapositive 18
Hépatite virale B
L'hépatite B est l'une des infections les plus courantes. Il y a environ 300 à 500 millions de patients atteints d’hépatite B chronique (CHB) dans le monde. Les régions à forte prévalence (10 à 20 %) comprennent l'Asie du Sud, la Chine, l'Indonésie, les pays d'Afrique tropicale, les îles du Pacifique et l'Alaska.
Diapositive 19
Étiologie
L'agent causal de l'infection par le VHB est un virus à ADN de la famille des Hepadnaviridae. Le génome du VHB est une molécule d’ADN circulaire double brin incomplète. Il existe 9 génotypes du virus (de A à H). Le virus est stable dans l’environnement extérieur.
Diapositive 20
Riz. 3 Virus de l'hépatite B
Diapositive 21
Épidémiologie
La principale voie de transmission est parentérale (injection, transfusion sanguine), ainsi que par les muqueuses et la peau endommagées. L'hépatite B se caractérise par une contagiosité élevée - l'infection est possible lorsqu'une quantité négligeable de matériel infecté (0,0001 ml de sang) entre en contact avec une peau ou des muqueuses endommagées.
Diapositive 22
Pathogénèse
Dans la pathogenèse de l'hépatite virale chronique B, le cycle biologique de développement du VHB (sa persistance, sa réplication et son intégration dans l'ADN de l'hépatocyte) et la réponse immunitaire du macro-organisme sont importants. (Fig.6)
Le virus de l'hépatite B n'a pas d'effet cytopathogène sur les hépatocytes, leurs dommages sont associés à des réactions immunopathologiques qui se produisent aux antigènes et autoantigènes viraux. Lorsqu'il est infecté par le VHB, la réplication de l'ADN du VHB et la synthèse de l'AgHBs, de l'AgHBe et de l'AgHBcorAg se produisent dans les hépatocytes. La réplication du virus est également possible en dehors du foie. HBsAg et HBcorAg ont été détectés dans les macrophages, les cellules des gonades, les glandes salivaires, la glande thyroïde, le pancréas et la moelle osseuse. La progression de l’hépatite chronique est associée à la réplication virale, qui soutient le processus immuno-inflammatoire.
Diapositive 23
Les principales cibles de l’agression immunitaire sont l’HBcorAg, l’HBeAg ainsi que les autoantigènes hépatiques. La cytolyse cellulaire dépendante des lymphocytes T et des anticorps revêt une importance capitale. Au cours de la phase de réplication, la réponse immunitaire aux antigènes circulants et tissulaires du VHB augmente, ce qui entraîne des lésions massives du parenchyme hépatique. Lorsque le virus entre dans la phase d'intégration, l'activité du processus inflammatoire dans le parenchyme hépatique diminue et, dans certains cas, un « porteur du virus » se forme lorsqu'une infiltration inflammatoire cellulaire et une nécrose ne sont pas détectées dans le tissu hépatique.
Diapositive 24
Riz. 4 Cycle de développement biologique du VHB
Diapositive 25
Clinique de l'hépatite virale aiguë B (AVHB)
La durée de la période d'incubation est de 30 à 180 jours (généralement 2 à 3 mois).
Période pré-ictérique : dure 3 à 15 jours et se caractérise par des symptômes d'intoxication (fièvre, faiblesse générale, léthargie, apathie, irritabilité, troubles du sommeil, perte d'appétit), arthralgie, douleur dans l'hypocondre droit. Dans certains cas, une éruption cutanée est observée. Au cours des 1 à 2 derniers jours des règles, les selles se décolorent et l'urine s'assombrit.
La période ictérique dure de 10 à 14 à 30 à 40 jours. La coloration de la jaunisse apparaît pour la première fois
Diapositive 26
sur les muqueuses, puis sur la peau. Les symptômes d'intoxication s'intensifient généralement après l'apparition de la jaunisse. Le foie et la rate (dans 30 à 50 % des cas) sont hypertrophiés. Une bradycardie apparaît, la tension artérielle diminue et les bruits cardiaques s'affaiblissent. Dans les formes sévères, une dépression du système nerveux central de gravité variable, des syndromes dyspeptiques et hémorragiques se développent. On distingue une forme maligne fulminante distincte, provoquée par une nécrose massive des hépatocytes avec développement d'une insuffisance rénale aiguë.
La période de convalescence commence après la disparition de l'ictère et se termine après la résolution clinique et biologique complète de la maladie, qui survient généralement 3 mois après son apparition.
Diapositive 27
Hépatite virale C
L'hépatite C est la forme la plus courante de maladie hépatique chronique dans la plupart des pays européens et en Amérique du Nord. Selon l’OMS, il y a au moins 170 millions de personnes infectées par le VHC dans le monde.
Diapositive 28
Étiologie
L'agent causal de l'infection par le VHC est un virus à ARN de la famille des Flaviviridae. Le génome du virus est formé d’ARN simple brin. Le VHC est génétiquement hétérogène : il existe 6 génotopes principaux (1 à 6) et au moins 50 sous-types.
Diapositive 29
Riz. 5 Virus de l'hépatite C
Diapositive 30
Épidémiologie
Selon l’OMS, il y a au moins 170 millions de personnes infectées par le VHC dans le monde. La prévalence de l'infection par le VHC varie également considérablement selon les régions, se situant en moyenne entre 0,5 et 2 % (jusqu'à 6,5 % dans les pays d'Afrique tropicale). L'infection par le VHC est à l'origine d'environ 40 % des cas de pathologie hépatique chronique. Le nombre total de personnes infectées par le VHC en Russie est de
1 million 700 mille personnes.
Diapositive 31
Pathogénèse
Le virus pénètre dans l’organisme de la même manière que le virus de l’hépatite B, bien qu’il puisse également pénétrer par la peau intacte. Ayant un tropisme pour les hépatocytes, le virus a sur ceux-ci un effet cytopathique direct. En raison de l’hétérogénéité génétique du virus de l’hépatite C, celui-ci présente de nombreuses variantes antigéniques, ce qui rend difficile la mise en œuvre d’une réponse immunitaire adéquate. Les particules virales pénètrent dans les cellules du système macrophage du corps et provoquent une certaine réaction de leur part, visant à éliminer le virus.
Diapositive 32
En raison du fait que la composition antigénique de la particule virale est similaire à la composition antigénique des hépatocytes et qu'à la surface des hépatocytes se trouvent également des fragments de particules virales synthétisées sur l'ARN viral pour un assemblage ultérieur dans le virus, il existe un mécanisme auto-immun. de dommages aux hépatocytes. De plus, on ne peut exclure un effet mutagène direct du virus de l'hépatite C sur les macrophages, modifiant leurs propriétés de telle sorte qu'ils deviennent capables de réagir avec les antigènes d'histocompatibilité du système HLA et de provoquer ainsi une réaction auto-immune.
Diapositive 33
Riz. 6 Cycle de vie du virus de l'hépatite C
Diapositive 34
Clinique de l'hépatite virale aiguë C (AVHC)
La durée de la période d'incubation est de 20 à 90 jours. L'AVGS est généralement bénigne, principalement sous forme anictérique ou subclinique. Son diagnostic est relativement rare.
Les symptômes les plus courants sont l'anorexie, les nausées, les vomissements, l'inconfort de l'hypocondre droit et parfois la jaunisse.
Le risque de chronicité est présent chez plus de 80 % des patients.
Diapositive 35
Hépatite virale D
L'hépatite D (hépatite delta) est une infection virale anthroponotique avec un mécanisme d'infection parentéral, caractérisée par des lésions inflammatoires du foie.
Diapositive 36
Étiologie
La maladie est causée par un virus à ARN partiel (HDV, virus δ), dont l'expression nécessite un VHB dont la taille du génome est de 19 nm. Appartient à la famille des Deltavirus.
Diapositive 37
Riz. 7 Virus de l'hépatite D
Diapositive 38
Épidémiologie
La voie de transmission est similaire à celle de l’infection par le VHB. L’infection par le HDV est plus courante en Europe du Sud, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Amérique centrale et du Sud. Il y a environ 15 millions de personnes atteintes d’hépatite D dans le monde.
Diapositive 39
Pathogénèse
Les mécanismes des lésions des tissus hépatiques causées par le HDV (virus de l’hépatite D) et l’hépatite D sous-jacente ne sont pas clairs. On pense que les lésions hépatiques sont largement associées à la réponse immunitaire à l’infection par le HDV (virus de l’hépatite D). Très probablement, cela est dû à l'interaction de facteurs tels que le génotype du HDV (virus de l'hépatite D), le système immunitaire du patient et les caractéristiques du VHB (virus de l'hépatite B) (génotype et activité de réplication).
Diapositive 40
Clinique de l'hépatite virale aiguë D (AVHD)
Les manifestations cliniques de la co-infection (infection simultanée par le VHB et le HDV) sont généralement identiques à celles du VHB. Les caractéristiques comprennent une période d'incubation plus courte, la présence d'une forte fièvre prolongée, l'apparition fréquente d'éruptions cutanées et des douleurs migrantes dans les grosses articulations. L'évolution est relativement favorable, le risque de chronicité n'est pas dépassé, comme pour le VHB.
Diapositive 41
Hépatite virale chronique
Les manifestations cliniques de l’hépatite chronique sont assez polymorphes et comprennent un large éventail de symptômes.
Le syndrome dyspeptique est associé à une violation de la fonction de détoxification du foie, à une pathologie concomitante du duodénum et du pancréas.
Le syndrome asthénique (faiblesse, fatigue, diminution des performances, irritabilité) s'exprime plus ou moins chez les patients atteints d'hépatite chronique.
Signes de lésions hépatiques :
Diapositive 42
Avec un processus actif, une hypertrophie, un durcissement et une sensibilité du foie sont généralement détectés ;
La jaunisse (parenchymateuse) est observée relativement rarement ;
Les télangiectasies et l'érythème palmaire sont causés par une augmentation des concentrations d'œstrogènes et des modifications de la sensibilité des récepteurs vasculaires. Leur gravité est en corrélation avec l'activité du processus et n'indique pas toujours une cirrhose du foie.
Dans l'hypertension portale (ascite, splénomégalie, varices œsophagiennes), des signes d'insuffisance hépatique apparaissent et progressent.
L'aménorrhée, la gynécomastie et la diminution de la libido sont associées à une altération du métabolisme des hormones sexuelles dans le foie (généralement au stade de la cirrhose).
Diapositive 43
Les manifestations extrahépatiques du CHB se développent assez rarement et sont généralement représentées par des lésions rénales, une périartérite noueuse ou une cryoglobulinémie. Un peu plus souvent, des manifestations extrahépatiques se développent avec le CHC. Cryoglobulinémie possible, glomérulonéphrite membraneuse, porphyrie cutanée tardive, thyroïdite auto-immune, moins fréquemment - syndrome de Sjögren, lichen plan, arthrite séronégative, anémie aplasique, lymphome à cellules B.
Diapositive 44
Recherche en laboratoire
Test sanguin clinique : augmentation possible de l'ESR, leucopénie, lymphocytose et sous forme fulminante d'AVH - leucocytose.
Analyse générale des urines : avec CVH et exacerbation de CVH, l'apparition de pigments biliaires (principalement bilirubine directe) et d'urobiline est possible.
Chimie sanguine:
Diapositive 45
Syndrome de cytolyse : augmentation des taux d'ALT, d'AST ;
Syndrome de cholestase : augmentation des taux de bilirubine totale, de cholestérol, de phosphatase alcaline, de γ-glutamyl transpeptidase, généralement observée avec la jaunisse ;
Syndrome d'inflammation mésenchymateuse : augmentation de la teneur en immunoglobulines, augmentation du test au thymol, diminution du test au sublimé ;
Syndrome d'insuffisance hépatocellulaire : diminution de l'indice de prothrombine, de la concentration sérique d'albumine, du cholestérol, de la bilirubine totale : détecté dans les formes sévères d'hépatite chronique.
Diapositive 46
Marqueurs du virus de l’hépatite :
Virus de l'hépatite B:
- L'AgHBs est détecté 1 à 10 semaines après l'infection, son apparition précède le développement des symptômes cliniques et une augmentation de l'activité ALT/AST. Avec une réponse immunitaire adéquate, elle disparaît 4 à 6 mois après l'infection.
- L'AgHBe indique la réplication virale dans les hépatocytes ; trouvé dans le sérum presque simultanément avec l'AgHBs ;
- L'anti-HBe (Ab à e-Ag) en combinaison avec les IgG anti-HBc et les anti-HBs indique l'achèvement complet du processus infectieux.
Diapositive 47
L’anti-HBc (Ab to Nuclear Ag) est un marqueur diagnostique important de l’infection. Les IgM anti-HBc sont l’un des premiers marqueurs sériques du CHBV et un marqueur sensible de l’infection par le VHB. Indique la réplication du virus et l'activité du processus dans le foie ; sa disparition sert d'indicateur soit de l'assainissement du corps de l'agent pathogène, soit du développement de la phase intégrative de l'infection par le VHB.
Les IgG anti-HBc persistent pendant de nombreuses années ; indiquer une infection existante ou antérieure.
L'ADN du VHB et l'ADN polymérase sont des marqueurs diagnostiques de la réplication du virus.
Diapositive 48
Virus de l'hépatite C :
L'ARN du VHC est le premier marqueur biochimique de l'infection et apparaît plusieurs jours à 8 semaines après l'infection. En cas de guérison de l'ARCVD, l'ARN viral disparaît du sang dans les 12 semaines suivant l'apparition des premiers symptômes.
L'anti-VHC est déterminé dans le sang au plus tôt 8 semaines après l'infection. Il est présent dans le sang d’environ la moitié des patients présentant une ARVHS cliniquement manifeste au début de la maladie. Dans les infections subcliniques, les AT apparaissent généralement beaucoup plus tard.
Virus de l'hépatite D : IgM anti-HDV, ARN HDV (marqueur de réplication HDV).
Diapositive 49
- Analyse des selles : diminution de la teneur ou absence de stercobiline en raison de l'arrêt du flux biliaire dans les intestins ; l'apparition de stercobiline dans les selles pendant la période ictérique de l'AVH est une preuve de la résolution de l'ictère.
- Concentration sanguine d'α-fœtoprotéine (dépistage du carcinome hépatocellulaire). Cette étude doit être menée dans la durée.
Diapositive 50
Etudes instrumentales
Modalités d'examen obligatoires :
- Échographie du foie et de la rate : caractérisée par une échogénicité accrue du parenchyme, un compactage le long des vaisseaux hépatiques ;
- Une biopsie hépatique est nécessaire pour évaluer l’étendue des lésions hépatiques.
- Méthodes d'examen supplémentaires :
- Tomodensitométrie de la cavité abdominale ;
- FEGDS.
Diapositive 51
Traitement
Traitement non médicamenteux :
- En cas d'HVC et d'exacerbations de CVH, il est nécessaire de respecter le repos au lit ou semi-alité.
- Une alimentation équilibrée est nécessaire. La consommation de protéines, de sodium et de liquides n'est limitée qu'en cas de cirrhose décompensée du foie.
- Il est recommandé d'éviter la consommation d'alcool.
Diapositive 52
Thérapie médicamenteuse :
Hépatite virale aiguë : le traitement est principalement symptomatique - thérapie par perfusion de désintoxication, entérosorbants, acide ursodésoxycholique en cas de cholestase sévère, dans les cas graves - corticostéroïdes.
Un traitement antiviral spécifique est indiqué pour les ARVHS. L'interféron alpha est généralement utilisé à la dose de 3 millions d'UI par voie sous-cutanée pendant 12 à 24 semaines en association avec la ribavirine, ce qui peut réduire considérablement le risque de développer une CHC.
Hépatite virale chronique B :
Interféron alpha à la dose de 5 millions d'UI/jour par voie sous-cutanée ou 10 millions d'UI 3 fois par semaine pendant 4 à 6 mois.
Diapositive 53
Peginterféron alfa-2a (PEGASIS) dose de 180 mcg, par voie sous-cutanée une fois par semaine. Durée du traitement – 1 an.
La lamivudine est prescrite à 100 mg/jour par voie orale. La durée du traitement est de 1 an.
Hépatite virale chronique C :
La thérapie combinée est généralement effectuée :
Peginterféron alfa-2a 180 mcg/kg en sous-cutanée une fois par semaine avec la ribavirine ou peginterféron alfa-2b 1,5 mcg/kg en sous-cutanée une fois par semaine avec la ribavirine dont la posologie dépend du poids corporel.
Une monothérapie par peginterféron alfa-2a ou alfa-2b est réalisée s'il existe des contre-indications à la prise de ribavirine.
Diapositive 54
Hépatite virale chronique D : le traitement de l’hépatite D chronique reste à ce jour un problème non résolu. Il est recommandé d'utiliser l'interféron alfa à fortes doses (9 à 10 millions d'UI par voie sous-cutanée tous les deux jours pendant au moins 48 semaines), mais l'efficacité d'un tel traitement est assez faible.
Diapositive 55
La prévention
Une prévention spécifique a été développée uniquement pour l'hépatite B et comprend :
- des mesures de prévention de la toxicomanie et de la promiscuité ;
- tests obligatoires des produits sanguins et des organes destinés à la transplantation pour détecter les marqueurs de l'hépatite virale.
- la nécessité pour les professionnels de santé de faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils
Diapositive 56
manipuler des matières infectieuses (sang et autres fluides médicaux) ou des instruments médicaux qui sont entrés en contact avec eux.
La vaccination contre l'hépatite B est recommandée à tous les nouveau-nés et enfants de moins de 12 ans, ainsi qu'aux adolescents et adultes à risque. En Fédération de Russie, des vaccins recombinants génétiquement modifiés sont utilisés à cette fin.
Diapositive 57
Examen médical du travail
L'invalidité temporaire chez les patients atteints d'hépatite chronique survient pendant la période d'exacerbation et dure 2 à 3 semaines pour le degré I d'activité du processus et 3 à 4 semaines pour le degré II. L'emploi rationnel des patients travaillant dans des conditions de travail contre-indiquées est effectué conformément aux conclusions et recommandations de la CEE.
Diapositive 58
Examen clinique
Des examens réguliers des patients sont effectués avec détermination obligatoire des principaux indicateurs biochimiques du sang : bilirubine, protéines et ses fractions, activité aminotransférase, prothrombine. Des options de traitement de base ou autres sont prescrites. La fréquence des examens dépend de la forme de l'hépatite chronique.
Présentation sur la discipline« Maladies infectieuses avec un cours sur l'infection et l'épidémiologie du VIH »
sur le thème : « Hépatites virales B, C, D ».
2013
HÉPATITE VIRALE
Un groupe de maladies virales anthroponotiques,uni principalement par l'hépatotropie
pathogènes et principales manifestations cliniques :
1) lésions hépatiques avec développement d'une toxicité générale
syndrome,
2) hépatosplénomégalie,
3) altération de la fonction hépatique et apparition d'un ictère.
Structure du foie
Fonctions hépatiques
Hépatite virale chronique (hépatite parentérale)
Hépatite virale chronique(CVH) est une inflammation chronique
foie causé par un hépatotrope
virus, continuant sans tendance
à une amélioration depuis au moins 6 mois.
La grande majorité des cas d'hépatite chronique
causée par les virus de l’hépatite B, C et D.
Hépatite virale B
L'hépatite B est l'une des plusinfections courantes. Dans le monde
ils sont environ 300 à 500 millions.
patients atteints d’hépatite B chronique.
Vers les régions à haut
la prévalence (10-20%) comprend
Asie du Sud, Chine, Indonésie, pays
Afrique tropicale, îles du Pacifique
océan, Alaska.
Étiologie
L'agent causal de l'infection par le VHB est un virus à ADNde la famille des Hepadnaviridae.
Le génome du VHB est incomplet
Molécule d'ADN circulaire double brin.
Il existe 9 génotypes du virus (de A à H).
Le virus est stable dans l’environnement extérieur.
Épidémiologie
Source : personne malade.Mécanisme d'infection :
1) parentérale
2) sexuel
3) verticale
4) droit
La principale voie de transmission est parentérale
(injection, transfusion sanguine), ainsi que par
muqueuses et peau endommagées.
La réceptivité naturelle est élevée. Pour l'hépatite
Caractérisé par une contagiosité élevée, une infection
possible en cas de contact avec une peau endommagée ou
muqueuses négligeables
matériel infecté (0,0001 ml de sang).
Groupe à risque
Les personnes qui ont plusieurs partenaires sexuels(les prostituées).
Hommes qui pratiquent des actes homosexuels.
Partenaires sexuels des personnes infectées.
Les personnes qui utilisent des drogues injectables.
Membres de la famille d’un patient atteint d’hépatite B chronique.
Enfants nés de mères infectées.
Chéri. ouvriers.
Patients sous hémodialyse (« rein artificiel ») ou
recevoir des transfusions sanguines fréquentes.
Pathogénèse
Le virus pénètre dans le corps humain, puisse diffuse de manière hématogène vers le foie, où
fixé sur les hépatocytes en raison de
récepteurs de surface contenant l’AgHBs.
Dans ce cas, l’agent pathogène n’a pas d’action directe
effet cytopathique sur les cellules hépatiques.
Les virions se multiplient et
antigènes. Dystrophique et
changements nécrobiotiques dans les hépatocytes,
une nécrose focale se produit et, dans les cas graves
nécrose massive du parenchyme hépatique.
Clinique de l’hépatite B
La durée de la période d'incubation est de 30 à 180 jours (généralement 2 à 3 mois).On distingue les variantes suivantes de l'évolution clinique de l'hépatite virale B :
A. Selon la cyclicité du flux :
I. Formes cycliques :
1. Hépatite B aiguë - asymptomatique (inapparente et subclinique), anictérique, ictérique
(avec une prédominance de cytolyse ou de cholestase) ;
2. Hépatite aiguë avec syndrome cholestatique.
II. Formulaires persistants :
1. Portage du VHB - forme asymptomatique chronique (portage de l'AgHBs et d'autres
antigènes viraux);
2. Hépatite virale chronique B, phase intégrative.
III. Formes progressives :
1. Hépatite fulminante (fulminante);
2. Hépatite subaiguë ;
3. Hépatite virale chronique B, phase réplicative (y compris avec cirrhose du foie).
IV. Hépatite virale B, aiguë ou chronique mixte, en association avec une hépatite virale
A, C, D, E, G.
B. Selon la gravité de la maladie : légère, modérée, sévère.
Clinique de l’hépatite B
Période pré-ictérique (prodromique) :dure 3 à 15 jours. et se caractérise par des symptômes
intoxication (fièvre, faiblesse générale, léthargie,
apathie, irritabilité, troubles du sommeil, diminution
appétit), arthralgie, douleur dans l'hypocondre droit.
Dans certains cas, une éruption cutanée est observée. DANS
les 1-2 derniers jours de la période surviennent
décoloration des selles et urine foncée.
Clinique de l’hépatite B
La période ictérique dure de 10 à 14 à 3 040 jours. Jaunisse au débutapparaît sur les muqueuses, puis sur la peau.
Symptômes d'intoxication après l'apparition d'un ictère
s'intensifient généralement. Foie et rate (dans 30 à 50 %
cas) sont en augmentation. Une bradycardie apparaît
diminution de la tension artérielle, affaiblissement des bruits cardiaques. À
dans les formes sévères, une dépression du SNC se développe
divers degrés de gravité, dyspeptique,
syndromes hémorragiques.
Clinique de l’hépatite B
La période de convalescence commenceaprès la disparition de la jaunisse et
se termine après la résolution clinique et biologique complète de la maladie, ce qui
survient généralement 3 mois après
l'a commencé.
Hépatite virale C
L'hépatite C est la forme la plus courantemaladies chroniques du foie chez
la plupart des pays européens et
Amérique du Nord.
Étiologie
L'agent causal de l'infection par le VHC est un virus à ARN de la familleFlaviviridés. Le génome du virus se forme
ARN simple brin. Le VHC est génétique
hétérogène : il y en a 6 principaux
génotypes (1 à 6) et au moins 50 sous-types.
Épidémiologie
Selon l'OMS, il n'existe pasmoins de 170 millions de personnes sont infectées par le VHC.
La prévalence de l'infection par le VHC est également
varie considérablement selon les régions,
en moyenne 0,5 à 2 % (jusqu'à 6,5 % en
pays d’Afrique tropicale). VHC-
l'infection provoque environ 40
% de cas de pathologie hépatique chronique.
Le nombre total de personnes infectées par le VHC dans
Russie – 1 million 700 mille personnes.
Épidémiologie
La source de l'infection est une personne malade ou un porteur du virus.Mécanisme d'infection :
1) parentérale
2) sexuel
3) verticale
4) droit
Voies de transmission :
1) lors de la transfusion de sang et de produits sanguins contaminés et lorsque
Transplantation d'organe;
2) avec des injections avec des seringues contaminées et des blessures causées par une injection
aiguille dans les établissements médicaux;
3) lors de la consommation de drogues injectables ;
4) un nouveau-né d'une personne infectée par l'hépatite C
mère.
Pathogénèse
Le virus pénètre dans l'organisme de la même manière que le virushépatite B. Ayant un tropisme pour les hépatocytes,
le virus a un impact direct sur eux
effet cytopathique. En raison de
hétérogénéité génétique du virus de l'hépatite
Il existe de nombreuses variantes antigéniques,
ce qui rend difficile la mise en œuvre adéquate
réponse immunitaire. Particules virales
pénétrer dans les cellules du système macrophage
corps et provoquer une certaine réaction
de leur part, visant à éliminer
virus.
Pathogénèse
En raison du fait que la composition antigénique du virusles particules sont similaires à la composition antigénique des hépatocytes,
et à la surface des hépatocytes il y a aussi
fragments de particules virales synthétisées sur
ARN viral pour assemblage ultérieur en un virus, puis
il existe un mécanisme auto-immun
dommages aux hépatocytes. De plus, ne
l'effet mutagène direct du virus est également exclu
hépatite C sur les macrophages, modifiant leurs propriétés
afin qu'ils soient capables de réagir avec
antigènes d'histocompatibilité du système HLA et
provoquant ainsi une réaction auto-immune.
Clinique de l'hépatite C
Du moment de l’infection aux manifestations cliniquesdure de 2-3 semaines à 6-12 mois.
En cas d'apparition aiguë de la maladie, la période initiale
dure 2-3 semaines, accompagné de douleurs articulaires,
fatigue, faiblesse, indigestion.
Une augmentation de la température est rarement observée. La jaunisse aussi
peu de caractéristique. L'hépatite C aiguë est diagnostiquée très
rarement et plus souvent par accident.
Après la phase aiguë de la maladie, une personne peut
guérir, la maladie peut devenir chronique
forme ou porteurs du virus. Chez la plupart des patients
(dans 70 à 80 % des cas), une évolution chronique se développe.
La transition de l’hépatite C aiguë à l’hépatite chronique se produit
progressivement : augmente sur plusieurs années
dommages aux cellules hépatiques, une fibrose se développe. Fonction
le foie peut persister longtemps. UN
premiers symptômes (jaunisse, hypertrophie abdominale,
varicosités sur la peau de l'abdomen, croissance
faiblesses) peuvent déjà apparaître avec une cirrhose du foie.
Hépatite virale D
Hépatite D (hépatite delta) - viraleinfection anthroponotique par voie parentérale
mécanisme d'infection pour lequel
caractérisé par une lésion inflammatoire
foie.
Étiologie
La maladie est causée par un virus à ARN incomplet (HDV, virus δ), pour l'expressionqui nécessite le VHB avec la taille du génome
19 milles marins. Appartient à la famille des Deltavirus.
Épidémiologie
Le réservoir et la source du pathogène est l’homme,malade ou porteur du virus. En distribution
virus, la principale préoccupation concerne les personnes atteintes
formes chroniques d'hépatite virale B,
simultanément infecté par un virus
hépatite D. Période de contagiosité des sources
infection indéfiniment longue, mais malade
le plus dangereux pendant la période aiguë de la maladie.
Mécanisme d'infection :
1) parentérale
2) sexuel
3) verticale
Épidémiologie
Le risque d'infection est particulièrement élevé pour les receveurs permanentsdons de sang ou de ses préparations, pour les personnes exposées à des
interventions parentérales, ainsi que pour les toxicomanes s'injectant
médicaments intraveineux.
La transmission transplacentaire de l'hépatite virale D est possible à partir de
fœtus enceinte.
Incidence élevée d’infection parmi les personnes impliquées dans
la promiscuité (surtout chez les hommes homosexuels), donne des raisons de croire que les rapports sexuels sont également possibles
voie d’infection.
La réceptivité naturelle est élevée. À l'hépatite virale D
Toutes les personnes atteintes d'hépatite virale D ou
sont porteurs de l'hépatite virale B. Très probablement
développement de l'hépatite virale D chez les porteurs chroniques de l'AgHBs.
Les populations des zones hyperendémiques sont particulièrement sensibles
pour l'hépatite virale B. Des formes graves de la maladie peuvent survenir
même chez les enfants.
Pathogénèse
L'agent pathogène est intégré dans le génome du virus de l'hépatite B, affectantsur sa synthèse et améliorer la réplication de cette dernière. La maladie peut
se manifeste par une co-infection lorsqu’il est simultanément infecté par des virus
hépatite virale B et hépatite virale D et surinfection dans les cas
lorsque le virus de l'hépatite D pénètre dans le corps humain, auparavant
infecté par le virus de l’hépatite B. Réplication du virus viral de l’hépatite B
l'hépatite D survient dans les cellules hépatiques.
Sur le plan pathomorphologique, l’hépatite virale D n’a pas de spécificité
signes qui la distinguent de l'hépatite virale B et se caractérise par
une image prononcée de nécrose, qui prévaut sur l'inflammatoire
réaction. Une nécrose massive et de petites gouttelettes sont observées dans les hépatocytes
obésité. Interaction entre les virus de l'hépatite B et les virus
l'hépatite D aggrave le processus pathologique et conduit au développement de maladies aiguës
insuffisance hépatique ou chronicité.
Clinique d'hépatite virale D
Période d'incubation. Pareil à celui pourhépatite virale B. En cas de co-infection
l'évolution clinique de la maladie est similaire
manifestations cliniques de l'hépatite virale B, mais avec
la prédominance d'une évolution sévère. En cas de surinfection
observé une forte aggravation de l'évolution du virus
hépatite B avec insuffisance fonctionnelle sévère
foie et le développement d'un grand nombre de formes chroniques,
conduisant à la formation rapide d’une cirrhose du foie.
1. Le syndrome dyspeptique est associé à
violation de la fonction de désintoxication
foie, pathologie concomitante du duodénum et du pancréas.
2. Syndrome asthénique (faiblesse,
fatigue, diminution des performances,
irritabilité) s'exprime en plus ou moins
dans une moindre mesure chez les patients atteints d'hépatite chronique.
Manifestations cliniques de l'hépatite virale chronique
Signes de lésions hépatiques :hypertrophie, durcissement et sensibilité du foie ;
jaunisse;
télangiectasie et érythème palmaire (dus à
une augmentation de la concentration d’œstrogènes et un changement de
sensibilité des récepteurs vasculaires
hypertension portale (ascite, splénomégalie,
varices de l'œsophage) apparaissent et
signes de progression de l’insuffisance hépatique.
aménorrhée, gynécomastie, diminution de la libido
associé à des perturbations du métabolisme des hormones sexuelles dans
foie (généralement au stade de la cirrhose).
Diagnostique
1. Données d'histoire épidémiologique(indications par voie parentérale
interventions, contact avec le patient,
administration de médicaments par voie intraveineuse
périodes correspondant à l'incubation
période).
2. Examen clinique (détection
cyclicité caractéristique de la maladie et
syndromes cliniques et biochimiques).
Recherche en laboratoire
Modalités d'examen obligatoires :UAC : ESR possible, leucopénie,
lymphocytose, avec la forme fulminante d'AVG
– la leucocytose.
OAM : avec OVH et exacerbation de CVH
apparition possible de pigments biliaires
(bilirubine directe principalement),
urobiline.
Recherche en laboratoire
Chimie sanguine:- syndrome de cytolyse : augmentation des taux d'ALT, AST ;
- syndrome de cholestase : augmentation du contenu total
bilirubine, cholestérol, phosphatase alcaline, γglutamyl transpeptidase, habituellement observées avec
jaunisse;
- syndrome d'inflammation mésenchymateuse : augmenté
teneur en immunoglobulines, augmentation du thymol
échantillons, diminution du test de sublimation ;
- syndrome d'insuffisance hépatique :
diminution de l'indice de prothrombine, de la concentration
albumine sérique, cholestérol, total
bilirubine : détectée dans les formes sévères d'hépatite chronique. Marqueurs:
Virus de l'hépatite B:
L'AgHBs est détecté 1 à 10 semaines après
infection, son apparition précède
développement de symptômes cliniques et
augmentation de l’activité ALT/AST. À
S'il y a une réponse immunitaire adéquate, elle disparaît
4 à 6 mois après l'infection
L'AgHBe indique une réplication virale dans
hépatocytes; trouvé dans le sérum
presque simultanément avec l'AgHBs ;
Anti-HBe (AT à e-Ag) en association avec anti-HBc
Les IgG et les anti-HBs indiquent un traitement complet
achèvement du processus infectieux. Anti-HBc (Ab to Nuclear Ag) – important
marqueur diagnostique de l’infection. Les IgM AntiHBc sont l’un des premiers sérums
marqueurs du CHBV et un marqueur sensible de l’infection par le VHB. Indique la réplication du virus et
activité du processus dans le foie; sa disparition
sert d'indicateur soit de l'assainissement du corps de
pathogène, ou le développement de la phase intégrative
Infections par le VHB.
Les IgG anti-HBc persistent pendant de nombreuses années ;
indiquer existant ou antérieur
infection passée.
ADN du VHB et ADN polymérase – diagnostic
marqueurs de la réplication du virus. Virus de l'hépatite C :
L'ARN du VHC est le premier marqueur biochimique
l'infection survient dans un délai de plusieurs jours à 8
semaines après l'infection. Dans les cas
récupération de CVHS, l'ARN viral disparaît de
sang dans les 12 semaines suivant la première comparution
symptômes.
L'anti-VHC est déterminé dans le sang au plus tôt après 8
semaines après l'infection. Il est présent dans le sang
environ la moitié des patients présentant des symptômes cliniques
manifester une OVHS au début de la maladie. À
les infections subcliniques AT apparaissent généralement
beaucoup plus tard.
Virus de l'hépatite D : IgM anti-HDV, ARN HDV (marqueur
réplication HDV).
Méthodes d'examen supplémentaires :
Analyse des selles : diminution du contenu oumanque de stercobiline dû à l'arrêt
le flux de bile dans les intestins ; apparence
stercobiline dans les selles pendant la période ictérique
WHG est une preuve de la résolution de la jaunisse.
Concentration sanguine d'α-fœtoprotéine
(dépistage du carcinome hépatocellulaire).
Cette recherche doit être menée dans
dynamique.
Etudes instrumentales
Méthodes requisesexamens :
Échographie du foie et de la rate :
caractérisé par une échogénicité accrue
parenchyme, compactions le long du
vaisseaux hépatiques;
Une biopsie hépatique est nécessaire pour
évaluer le degré de lésions hépatiques.
Méthodes supplémentaires
examens :
Tomodensitométrie de la cavité abdominale ;
FEGDS.
Traitement
1. Les patients atteints d'hépatite virale sont soumis à un contrôle obligatoirehospitalisation dans un hôpital d'infectiologie (département,
hôpital).
2. Régime alimentaire à long terme, voire à vie
mode (tableau n°5).
Hépatite virale aiguë : traitement préférentiel
symptomatique – perfusion de désintoxication
thérapie, entérosorbants, acide ursodésoxycholique pour
cholestase sévère, dans les cas graves - GCS.
Un traitement antiviral spécifique est indiqué pour
OVGS. L'interféron alpha est généralement utilisé à 3 millions
UI par voie sous-cutanée pendant 12 à 24 semaines en association avec
la ribavirine, qui peut réduire considérablement le risque
développement des CHC.
Traitement
Hépatite virale chronique B :-Interféron alpha à la dose de 5 millions UI/jour par voie sous-cutanée ou 10 millions UI
3 fois par semaine pendant 4 à 6 mois.
- Peginterféron alfa-2a (PEGASIS) dose 180 mcg, par voie sous-cutanée 1
une fois par semaine. Durée du traitement – 1 an.
-La lamivudine est prescrite à 100 mg/jour par voie orale.
La durée du traitement est de 1 an.
Hépatite virale chronique C :
La thérapie combinée est généralement effectuée :
- peginterféron alfa-2a 180 mcg/kg par voie sous-cutanée une fois par semaine avec
ribavirine ou peginterféron alfa-2b 1,5 mcg/kg par voie sous-cutanée
Une fois par semaine avec la ribavirine dont la posologie dépend de
poids.
Une monothérapie par peginterféron alfa-2a ou alfa-2b est réalisée
s'il existe des contre-indications à la prise de ribavirine.
Traitement
Hépatite virale chronique D :traitement de l'hépatite D chronique avant
reste actuellement non résolu
problème. Utilisation recommandée
interféron alpha à fortes doses (9-10
millions d'UI par voie sous-cutanée tous les deux jours sans
moins de 48 semaines), mais l'efficacité est la même
la thérapie est assez faible.
La prévention
1. Prévention non spécifique :a) maintenir l'hygiène, personnelle et publique ;
b) s'il existe un risque d'infection, utiliser des moyens individuels
protection, désinfection et stérilisation
instruments médicaux;
c) l'hospitalisation et le traitement des patients chroniques,
infecté par les virus de l'hépatite B C D ou leurs combinaisons,
séparément des autres patients ;
d) le travail culturel et éducatif auprès de la population ;
d) parce que la probabilité d'infection et de développement du virus est importante
dépend dans une large mesure de l'état initial de l'organisme, alors comme
des mesures de prévention peuvent être envisagées pour améliorer la santé et
renforcer sa propre défense immunitaire, y compris
phytosanté (préparations immunomodulatrices et
adaptogènes).
La prévention
2. Prévention spécifique :Prévention spécifique des hépatites virales
divisé en prévention pré-infectieuse et prévention
après une éventuelle infection.
Prévention spécifique avant l'infection aujourd'hui
réalisée uniquement pour l'hépatite B. Méthode
vaccination avec le vaccin contre l'hépatite B (méd.
tous les employés).
Un vaccin contre le virus de l'hépatite C est en cours de développement.
Prévention spécifique après possible
l'infection est un rendez-vous urgent
médicaments antiviraux en association avec
interféron.
Examen clinique
Au moins 1 an.Des examens réguliers des patients atteints
détermination obligatoire dans le sang
principaux indicateurs biochimiques :
la bilirubine, les protéines et ses fractions,
activité des aminotransférases, de la prothrombine,
Marqueurs AgHBs. Attribué de base ou
d'autres options de traitement.
2 Introduction L'auto-assistance grâce à la connaissance ! Les informations présentées ici sont uniquement destinées à vous aider à comprendre et à garder l’hépatite C sous contrôle. Cela ne remplace pas la consultation d'un spécialiste. Tout patient atteint d'hépatite C doit consulter un médecin pour toutes questions de diagnostic et de traitement.


500 réactions chimiques) Bile Système immunitaire Détoxification Facteurs de coagulation sanguine Hormones Capable d'auto-guérison!" title="4 Fonctions hépatiques Laboratoire de chimie (>500 réactions chimiques) Bile Système immunitaire Détoxification des toxines Facteurs de coagulation sanguine Hormones Capable d'auto-guérison -guérison !" class="link_thumb"> 4 !} 4 Fonctions hépatiques Laboratoire de chimie (>500 réactions chimiques) Bile Système immunitaire Détoxification Facteurs de coagulation sanguine Hormones Capable d'auto-guérison ! 500 réactions chimiques) Bile Système immunitaire Nettoyage des toxines Facteurs de coagulation sanguine Hormones Capable d'auto-guérison!" > 500 réactions chimiques) Bile Système immunitaire Nettoyage des toxines Facteurs de coagulation sanguine Hormones Capable d'auto-guérison!" > 500 réactions chimiques) Bile Immunité système Nettoyage des toxines Facteurs de coagulation sanguine Hormones Capable d'auto-guérison!" title="4 Fonctions hépatiques Laboratoire chimique (>500 réactions chimiques) Bile Système immunitaire Nettoyage des toxines Facteurs de coagulation sanguine Hormones Capable d'auto-guérison !"> title="4 Fonctions hépatiques Laboratoire de chimie (>500 réactions chimiques) Bile Système immunitaire Détoxification Facteurs de coagulation sanguine Hormones Capable d'auto-guérison !"> !}



8 Test d'anticorps Tests Elisa II ou III Tests les plus courants pour le VHC Test RIBA Généralement effectué uniquement en l'absence de facteurs de risque Un résultat de test positif indique que le corps a été exposé au virus N'indique PAS une infection active Un test viral est effectué pour détecter une infection active charge de VHC

10 UI/ml ADN du VHC par analyse de l'ADN-P – > 50 UI/ml TA – > 5-10 UI/ml Pourquoi les tests de charge virale sont-ils importants ? Détecter la présence d'une infection active Aide à prédire la réponse au traitement Montrer si le" title="9 Tests de charge virale ADN du VHC par PCR - >10 UI/ml ADN du VHC par analyse ADN-R -> 50 UI/ml TA – > 5-10 UI/ml Pourquoi les tests de charge virale sont importants : Détecter la présence d’une infection active Aide à prédire la réponse au traitement Montrer si le traitement fonctionne" class="link_thumb"> 9 !} 9 Tests de charge virale ADN du VHC par PCR - >10 UI/ml ADN du VHC par analyse de l'ADN-R - > 50 UI/ml TA -> 5-10 UI/ml Pourquoi les tests de charge virale sont-ils importants ? Détecte la présence d'une infection active Aide à prédire la réponse au traitement Indique si le traitement donne un résultat positif ** LA CHARGE VIRALE N'EST PAS EN CORRÉLATION AVEC L'ÉVOLUTION DE LA MALADIE ** 10 UI/ml ADN du VHC par analyse de l'ADN-P – > 50 UI/ml TA – > 5-10 UI/ml Pourquoi les tests de charge virale sont-ils importants ? Détecter la présence d'une infection active Aide à prédire la réponse au traitement Montrer si le "> 10 UI/ml d'ADN du VHC par analyse P-DNA - > 50 UI/ml TA -> 5-10 UI/ml Pourquoi les tests de charge virale sont-ils importants ? Détecter la présence d'une infection active Aide à prédire la réponse au traitement Montrer si le traitement donne un résultat positif ** LA CHARGE VIRALE N'EST PAS EN CORRÉLATION AVEC LE DÉVELOPPEMENT DE LA MALADIE ** "> 10 UI/ml d'ADN du VHC par analyse de l'ADN-R – > 50 UI/ml TA – > 5- 10 UI/ml Pourquoi les tests de charge virale sont-ils importants ? Détecter la présence d'une infection active Aide à prédire la réponse au traitement Montrer si le" title="9 Tests de charge virale ADN du VHC par PCR - >10 UI/ml ADN du VHC par analyse ADN-R -> 50 UI/ml TA – > 5-10 UI/ml Pourquoi les tests de charge virale sont importants : Détecter la présence d’une infection active Aide à prédire la réponse au traitement Montrer si le traitement fonctionne"> title="9 Tests de charge virale ADN du VHC par PCR - >10 UI/ml ADN du VHC par analyse de l'ADN-R - > 50 UI/ml TA -> 5-10 UI/ml Pourquoi les tests de charge virale sont-ils importants ? Détecte la présence d’une infection active Aide à prédire la réponse au traitement Montre si le traitement fonctionne"> !}



13 Transmission du virus Aiguilles partagées Accessoires pour drogues Transfusions sanguines avant 1992 – dons de sang, produits sanguins, procédure de transfusion Par contact sexuel (1-3 %) Agents de santé – piqûres accidentelles avec des aiguilles contaminées Articles ménagers partagés – rasoirs et brosses à dents De la mère à l'enfant

14 Conseils pour prévenir les infections Médicaments injectables et non injectables N'utilisez pas les seringues, les autoclaves, les pailles, les tubes, le coton - tout objet pouvant avoir été en contact avec le sang d'autrui. Eau de Javel pour la désinfection Relations sexuelles monogames stables Il n'est pas nécessaire de changer habitudes sexuelles existantes, mais soyez conscient du risque ! (Centre américain pour la prévention des maladies)



17 Conseils pour prévenir l'infection Tatouages et perçages Dans les salons spécialisés, le risque est faible Assurez-vous d'utiliser des aiguilles jetables, des flacons de mascara séparés et des règles générales de sécurité respectées Le risque d'infection est beaucoup plus élevé si le perçage est effectué dans conditions non spécialisées Par exemple, dans une prison ou dans la rue

18 Produits de soins personnels À la maison Couvrez les coupures ou les plaies Ne partagez pas de produits de soins personnels (brosses à dents, rasoirs, etc.) Dans les établissements de santé ou les lieux offrant des services d'hygiène Respectez les précautions standard Équipement jetable Apportez vos propres produits de soins personnels



21 Développement de la maladie Chez 10 à 25 % des porteurs du virus, l'infection évolue en une maladie grave en quelques années. Fibrose Cicatrices mineures Cirrhose Compensée - non compensée Stéatose Dépôts graisseux dans le foie

22 Traitement Principes généraux du traitement État de santé général Présence d'infection active Taux d'ALT élevés Maladie hépatique compensée Plus souvent positif chez : les jeunes femmes Indice de masse corporelle (IMC) et poids faibles Moins de stéatose Faible charge virale Dommages hépatiques minimes Avec les génotypes 2 et 3

23 Traitement – données cliniques Prospectif – essais cliniques bien menés avec des résultats mesurables Norme de référence Rétrospective – examen des données d'essais cliniques antérieurs Important pour identifier les orientations et planifier les recherches futures



26 Traitement - schémas standards Schering - PEG-Intron + Rebetol (800 mg) Pour le génotype 1 - réponse virologique soutenue (RVS) chez 41 % (après 48 semaines de traitement) Pour les génotypes - chez 75 % (après 48 semaines de traitement) Roche – Pegasys + Copegus (mg) Génotype 1 – RVS dans 44-51% (48 semaines de traitement) Génotypes 2 et 3 – RVS dans 82% (24 semaines de traitement) Génotype – RVS dans 70% (48 semaines de traitement)* Voir encadré US Federal Food and Drug Administration

27 Effets secondaires Interféron Fatigue chronique Douleurs musculaires et articulaires Nausées Maux de tête Anxiété Dépression Irritations cutanées Et autres... Ribavirine Augmente les effets secondaires de l'interféron, notamment la fatigue chronique et l'anémie ** (les hommes comme les femmes doivent utiliser des contraceptifs)

28 Gérer les effets secondaires Injections avant de se coucher Boire autant que possible (eau) Ibuprofène ou paracétamol à petites doses Analgésiques Exercice léger Hydrater la peau Différents sites d'injection Antidépresseurs Repos suffisant Manger fréquemment de petites quantités de nourriture L'essentiel : un soutien total - médecins, famille , amis, collègues




32 Votre propre avocat ! Essayez d'en apprendre le plus possible sur l'hépatite C Établissez une relation de confiance avec votre médecin Amenez un avocat à vos rendez-vous chez le médecin Posez des questions Conservez des copies de tous les tests médicaux Tenez un journal Ne vous limitez pas aux limites habituelles

33 Ressources – Fiche d'information sur le HCV Advocate Matériel pédagogique en anglais, espagnol, russe, français, allemand, chinois, vietnamien et tagalog Articles du Medical Writers Circle Pages d'informations factuelles en anglais, espagnol, français et russe Liste des groupes de soutien Liens recommandés Informations sur l'hépatite C et B et co-infection VIH/VHC

Diapositive 1
Département de Thérapie Polyclinique Faculté de Médecine HÉPATITE VIRALE Complété par les étudiants gr. L-608 B : Semionova S.I. Fazylova S.T. Imankoulova A.R. Sagitova Z.Z.Diapositive 2
 L'hépatite virale est un groupe de maladies causées par des virus hépatotropes, caractérisées par des lésions hépatiques prédominantes avec développement d'un syndrome toxique général, d'une hépatosplénomégalie, d'un dysfonctionnement et de l'apparition d'un ictère.
L'hépatite virale est un groupe de maladies causées par des virus hépatotropes, caractérisées par des lésions hépatiques prédominantes avec développement d'un syndrome toxique général, d'une hépatosplénomégalie, d'un dysfonctionnement et de l'apparition d'un ictère.
Diapositive 3

Diapositive 4
 1. Hépatite infectieuse (virale) : - Hépatite entérale : Hépatite A Hépatite E - Hépatite parentérale : Hépatite B Hépatite C Hépatite D Hépatite F Hépatite G - Hépatite en tant que composante de : fièvre jaune, infection à cytomégalovirus, rubéole, oreillons, infection par le virus Epstein - Barr, diverses infections herpétiques, fièvre de Lassa, SIDA. - Hépatite bactérienne : avec leptospirose, syphilis. 2. Hépatite toxique 3. Hépatite radiologique (une composante du mal des rayons) 4. Hépatite résultant de maladies auto-immunes Classification étiotropique de l'hépatite
1. Hépatite infectieuse (virale) : - Hépatite entérale : Hépatite A Hépatite E - Hépatite parentérale : Hépatite B Hépatite C Hépatite D Hépatite F Hépatite G - Hépatite en tant que composante de : fièvre jaune, infection à cytomégalovirus, rubéole, oreillons, infection par le virus Epstein - Barr, diverses infections herpétiques, fièvre de Lassa, SIDA. - Hépatite bactérienne : avec leptospirose, syphilis. 2. Hépatite toxique 3. Hépatite radiologique (une composante du mal des rayons) 4. Hépatite résultant de maladies auto-immunes Classification étiotropique de l'hépatite
Diapositive 5
 Hépatite virale A, E (hépatite entérale) Hépatite A Hépatite E Définition Maladie infectieuse à mécanisme de transmission fécale-orale, caractérisée cliniquement et morphologiquement par des lésions hépatiques avec développement d'un complexe symptomatique d'hépatite aiguë. Lésion hépatique infectieuse aiguë, se manifestant par des symptômes d'intoxication et, plus rarement, un ictère
Hépatite virale A, E (hépatite entérale) Hépatite A Hépatite E Définition Maladie infectieuse à mécanisme de transmission fécale-orale, caractérisée cliniquement et morphologiquement par des lésions hépatiques avec développement d'un complexe symptomatique d'hépatite aiguë. Lésion hépatique infectieuse aiguë, se manifestant par des symptômes d'intoxication et, plus rarement, un ictère
Diapositive 6
 Étiologie Virus de l'hépatite A (VHA) genre Hepatovirus famille Picornaviridae virus à ARN simple brin résistant aux acides, aux alcalis, à l'éther et au chloroforme ébullition destructrice pendant 3 à 5 minutes (Fig. 1) Virus de l'hépatite E (HEV) - genre Calicivirus famille Caliciviridae ARN simple brin - contenant le virus, résistant aux solutions désinfectantes, aux basses températures, moins virulent que le VHA (Fig. 2) Épidémiologie Source d'infection : patients subcliniques patients anictériques patients ictériques Source d'infection : patients subcliniques patients anictériques patients ictériques
Étiologie Virus de l'hépatite A (VHA) genre Hepatovirus famille Picornaviridae virus à ARN simple brin résistant aux acides, aux alcalis, à l'éther et au chloroforme ébullition destructrice pendant 3 à 5 minutes (Fig. 1) Virus de l'hépatite E (HEV) - genre Calicivirus famille Caliciviridae ARN simple brin - contenant le virus, résistant aux solutions désinfectantes, aux basses températures, moins virulent que le VHA (Fig. 2) Épidémiologie Source d'infection : patients subcliniques patients anictériques patients ictériques Source d'infection : patients subcliniques patients anictériques patients ictériques
Diapositive 7

Diapositive 8

Diapositive 9
 Mécanisme de transmission : contact fécal-oral eau domestique alimentaire Incidence : principalement enfants et adolescents (environ 80 %) saisonnalité été-automne immunité stable, tout au long de la vie. Le mécanisme de transmission : contact fécal-oral-eau domestique par voie alimentaire Incidence : irrégularité fortement exprimée principalement chez les personnes de 15 à 25 ans, mortalité élevée. Pathogenèse - effet cytopathique direct du virus, syndrome de cytolyse, syndrome de cholestase ___
Mécanisme de transmission : contact fécal-oral eau domestique alimentaire Incidence : principalement enfants et adolescents (environ 80 %) saisonnalité été-automne immunité stable, tout au long de la vie. Le mécanisme de transmission : contact fécal-oral-eau domestique par voie alimentaire Incidence : irrégularité fortement exprimée principalement chez les personnes de 15 à 25 ans, mortalité élevée. Pathogenèse - effet cytopathique direct du virus, syndrome de cytolyse, syndrome de cholestase ___
Diapositive 10
 - mésenchymateux - syndrome inflammatoire ___ Clinique Période d'incubation - 7-50 jours I. Période pré-ictérique (1 semaine) : - syndrome dyspeptique (douleurs abdominales, nausées, vomissements, anorexie, diarrhée) - variante pseudo-grippale (fièvre, toux, nez qui coule) - syndrome asthéno-végétatif (faiblesse soudaine) Période d'incubation – 20-65 jours I. Période pré-ictérique (apparition progressive, durée 3-5 jours) : - syndrome dyspeptique (douleurs abdominales, nausées, vomissements, anorexie, diarrhée) - variante pseudo-grippale (toux, écoulement nasal, fièvre peut être absente) - latente
- mésenchymateux - syndrome inflammatoire ___ Clinique Période d'incubation - 7-50 jours I. Période pré-ictérique (1 semaine) : - syndrome dyspeptique (douleurs abdominales, nausées, vomissements, anorexie, diarrhée) - variante pseudo-grippale (fièvre, toux, nez qui coule) - syndrome asthéno-végétatif (faiblesse soudaine) Période d'incubation – 20-65 jours I. Période pré-ictérique (apparition progressive, durée 3-5 jours) : - syndrome dyspeptique (douleurs abdominales, nausées, vomissements, anorexie, diarrhée) - variante pseudo-grippale (toux, écoulement nasal, fièvre peut être absente) - latente
Diapositive 11
 II. Période de jaunisse : - augmentation rapide de la jaunisse (au cours de la première semaine) ; disparition des symptômes d'intoxication après l'apparition de la jaunisse ; la durée de la période de jaunisse est en moyenne de 2 à 3 semaines ; évolution principalement légère et modérée de la maladie (97- 98 % ); période de récupération de 1 à 3 mois. II. Période de jaunisse : les symptômes d'intoxication persistent jusqu'à une semaine et s'aggravent chez la femme enceinte dans la seconde moitié de la grossesse ; des formes cholestatiques peuvent se développer dans 20 à 30 %. Diagnostic Plaintes (voir clinique) Antécédents Données physiques : - hépatomégalie ___
II. Période de jaunisse : - augmentation rapide de la jaunisse (au cours de la première semaine) ; disparition des symptômes d'intoxication après l'apparition de la jaunisse ; la durée de la période de jaunisse est en moyenne de 2 à 3 semaines ; évolution principalement légère et modérée de la maladie (97- 98 % ); période de récupération de 1 à 3 mois. II. Période de jaunisse : les symptômes d'intoxication persistent jusqu'à une semaine et s'aggravent chez la femme enceinte dans la seconde moitié de la grossesse ; des formes cholestatiques peuvent se développer dans 20 à 30 %. Diagnostic Plaintes (voir clinique) Antécédents Données physiques : - hépatomégalie ___
Diapositive 12
 splénomégalie flatulences bradycardie évaluation visuelle des urines (foncées) Données de laboratoire : NFS : leucopénie lymphocytose thrombocytopénie OAM : holiurie HD : bilirubinémie (fraction directe) hypertransaminasémie ___
splénomégalie flatulences bradycardie évaluation visuelle des urines (foncées) Données de laboratoire : NFS : leucopénie lymphocytose thrombocytopénie OAM : holiurie HD : bilirubinémie (fraction directe) hypertransaminasémie ___
Diapositive 13
 (ALT et AST augmentées de 20 à 100 fois) dysprotéinémie augmentation des marqueurs de cholestase (phosphatase alcaline, GGT, cholestérol, 5-NK) augmentation du test au thymol diminution du test au mercure Tests sérologiques : - IgM anti-VHA dans le sérum sanguin par ELISA - indicateur d'infection activité - les IgG anti-VHA sont un indicateur d'une infection passée. - ARN-VHE par PCR dans le sang ___ Tests sérologiques : - IgM anti-VHE dans le sérum sanguin par ELISA - indicateur d'activité infectieuse - ARN-VHE par PCR dans le sang
(ALT et AST augmentées de 20 à 100 fois) dysprotéinémie augmentation des marqueurs de cholestase (phosphatase alcaline, GGT, cholestérol, 5-NK) augmentation du test au thymol diminution du test au mercure Tests sérologiques : - IgM anti-VHA dans le sérum sanguin par ELISA - indicateur d'infection activité - les IgG anti-VHA sont un indicateur d'une infection passée. - ARN-VHE par PCR dans le sang ___ Tests sérologiques : - IgM anti-VHE dans le sérum sanguin par ELISA - indicateur d'activité infectieuse - ARN-VHE par PCR dans le sang
Diapositive 14
 Traitement Traitement non médicamenteux : une réhydratation adéquate est nécessaire (en augmentant la quantité de liquide ingérée à 1,5-2 litres par jour), le repos au lit est indiqué, une abstinence complète de consommation d'alcool est requise. Traitement médicamenteux : Cholestyramine (4 g par voie orale 2 fois par jour). ) est un remède symptomatique contre les démangeaisons cutanées. Prednisolone (30 mg/jour avec réduction progressive de la dose) Acide ursodésoxycholique (10-15 mg/kg/jour pendant 4-6 semaines) ___
Traitement Traitement non médicamenteux : une réhydratation adéquate est nécessaire (en augmentant la quantité de liquide ingérée à 1,5-2 litres par jour), le repos au lit est indiqué, une abstinence complète de consommation d'alcool est requise. Traitement médicamenteux : Cholestyramine (4 g par voie orale 2 fois par jour). ) est un remède symptomatique contre les démangeaisons cutanées. Prednisolone (30 mg/jour avec réduction progressive de la dose) Acide ursodésoxycholique (10-15 mg/kg/jour pendant 4-6 semaines) ___
Diapositive 15
 Prévention 1. Respect des règles d'hygiène personnelle. 2. Contrôle de la qualité de l'eau potable et des aliments. 3. L'immunoprophylaxie de l'hépatite A comprend l'administration d'un vaccin ou d'immunoglobulines. 1. Respect des règles d'hygiène personnelle. 2. Contrôle de la qualité de l'eau potable et des aliments. 3. Il n’existe pas d’immunoprophylaxie spécifique.
Prévention 1. Respect des règles d'hygiène personnelle. 2. Contrôle de la qualité de l'eau potable et des aliments. 3. L'immunoprophylaxie de l'hépatite A comprend l'administration d'un vaccin ou d'immunoglobulines. 1. Respect des règles d'hygiène personnelle. 2. Contrôle de la qualité de l'eau potable et des aliments. 3. Il n’existe pas d’immunoprophylaxie spécifique.
Diapositive 16
 Hépatite virale chronique (hépatite parentérale) L'hépatite virale chronique (HVC) est une inflammation chronique du foie provoquée par des virus hépatotropes, qui dure sans tendance à s'améliorer pendant au moins 6 mois. La grande majorité des cas d'hépatite chronique sont provoqués par les virus de l'hépatite B, C et D. Le rôle des autres virus hépatotropes (F, G, TTV, SEN, etc.) est discutable.
Hépatite virale chronique (hépatite parentérale) L'hépatite virale chronique (HVC) est une inflammation chronique du foie provoquée par des virus hépatotropes, qui dure sans tendance à s'améliorer pendant au moins 6 mois. La grande majorité des cas d'hépatite chronique sont provoqués par les virus de l'hépatite B, C et D. Le rôle des autres virus hépatotropes (F, G, TTV, SEN, etc.) est discutable.
Diapositive 17
 Classification des hépatites chroniques (adoptée au Congrès international des gastro-entérologues de Los Angeles en 1994)
Classification des hépatites chroniques (adoptée au Congrès international des gastro-entérologues de Los Angeles en 1994)
Diapositive 18
 Hépatite virale B L'hépatite B est l'une des infections les plus courantes. Il y a environ 300 à 500 millions de patients atteints d’hépatite B chronique (CHB) dans le monde. Les régions à forte prévalence (10 à 20 %) comprennent l'Asie du Sud, la Chine, l'Indonésie, les pays d'Afrique tropicale, les îles du Pacifique et l'Alaska.
Hépatite virale B L'hépatite B est l'une des infections les plus courantes. Il y a environ 300 à 500 millions de patients atteints d’hépatite B chronique (CHB) dans le monde. Les régions à forte prévalence (10 à 20 %) comprennent l'Asie du Sud, la Chine, l'Indonésie, les pays d'Afrique tropicale, les îles du Pacifique et l'Alaska.
Diapositive 19
 Étiologie L'agent causal de l'infection par le VHB est un virus à ADN de la famille des Hepadnaviridae. Le génome du VHB est une molécule d’ADN circulaire double brin incomplète. Il existe 9 génotypes du virus (de A à H). Le virus est stable dans l’environnement extérieur.
Étiologie L'agent causal de l'infection par le VHB est un virus à ADN de la famille des Hepadnaviridae. Le génome du VHB est une molécule d’ADN circulaire double brin incomplète. Il existe 9 génotypes du virus (de A à H). Le virus est stable dans l’environnement extérieur.
Diapositive 20

Diapositive 21
 Épidémiologie La principale voie de transmission est parentérale (injection, transfusion sanguine), ainsi que par les muqueuses et la peau endommagées. L'hépatite B se caractérise par une contagiosité élevée - l'infection est possible lorsqu'une quantité négligeable de matériel infecté (0,0001 ml de sang) entre en contact avec une peau ou des muqueuses endommagées.
Épidémiologie La principale voie de transmission est parentérale (injection, transfusion sanguine), ainsi que par les muqueuses et la peau endommagées. L'hépatite B se caractérise par une contagiosité élevée - l'infection est possible lorsqu'une quantité négligeable de matériel infecté (0,0001 ml de sang) entre en contact avec une peau ou des muqueuses endommagées.
Diapositive 22
 Pathogenèse Dans la pathogenèse de l'hépatite virale chronique B, le cycle biologique de développement du VHB (sa persistance, sa réplication et son intégration dans l'ADN de l'hépatocyte) et la réponse immunitaire du macro-organisme sont importants. (Fig. 6) Le virus de l'hépatite B n'a pas d'effet cytopathogène sur les hépatocytes, leurs dommages sont associés à des réactions immunopathologiques qui se produisent aux antigènes et autoantigènes viraux. Lorsqu'il est infecté par le VHB, la réplication de l'ADN du VHB et la synthèse de l'AgHBs, de l'AgHBe et de l'AgHBcorAg se produisent dans les hépatocytes. La réplication du virus est également possible en dehors du foie. HBsAg et HBcorAg ont été détectés dans les macrophages, les cellules des gonades, les glandes salivaires, la glande thyroïde, le pancréas et la moelle osseuse. La progression de l’hépatite chronique est associée à la réplication virale, qui soutient le processus immuno-inflammatoire.
Pathogenèse Dans la pathogenèse de l'hépatite virale chronique B, le cycle biologique de développement du VHB (sa persistance, sa réplication et son intégration dans l'ADN de l'hépatocyte) et la réponse immunitaire du macro-organisme sont importants. (Fig. 6) Le virus de l'hépatite B n'a pas d'effet cytopathogène sur les hépatocytes, leurs dommages sont associés à des réactions immunopathologiques qui se produisent aux antigènes et autoantigènes viraux. Lorsqu'il est infecté par le VHB, la réplication de l'ADN du VHB et la synthèse de l'AgHBs, de l'AgHBe et de l'AgHBcorAg se produisent dans les hépatocytes. La réplication du virus est également possible en dehors du foie. HBsAg et HBcorAg ont été détectés dans les macrophages, les cellules des gonades, les glandes salivaires, la glande thyroïde, le pancréas et la moelle osseuse. La progression de l’hépatite chronique est associée à la réplication virale, qui soutient le processus immuno-inflammatoire.
Diapositive 23
 Les principales cibles de l’agression immunitaire sont l’HBcorAg, l’HBeAg ainsi que les autoantigènes hépatiques. La cytolyse cellulaire dépendante des lymphocytes T et des anticorps revêt une importance capitale. Au cours de la phase de réplication, la réponse immunitaire aux antigènes circulants et tissulaires du VHB augmente, ce qui entraîne des lésions massives du parenchyme hépatique. Lorsque le virus entre dans la phase d'intégration, l'activité du processus inflammatoire dans le parenchyme hépatique diminue et, dans certains cas, un « porteur du virus » se forme lorsqu'une infiltration inflammatoire cellulaire et une nécrose ne sont pas détectées dans le tissu hépatique.
Les principales cibles de l’agression immunitaire sont l’HBcorAg, l’HBeAg ainsi que les autoantigènes hépatiques. La cytolyse cellulaire dépendante des lymphocytes T et des anticorps revêt une importance capitale. Au cours de la phase de réplication, la réponse immunitaire aux antigènes circulants et tissulaires du VHB augmente, ce qui entraîne des lésions massives du parenchyme hépatique. Lorsque le virus entre dans la phase d'intégration, l'activité du processus inflammatoire dans le parenchyme hépatique diminue et, dans certains cas, un « porteur du virus » se forme lorsqu'une infiltration inflammatoire cellulaire et une nécrose ne sont pas détectées dans le tissu hépatique.
Diapositive 24

Diapositive 25
 Clinique de l'hépatite virale aiguë B (AVHB) La durée de la période d'incubation est de 30 à 180 jours (généralement 2-3 mois). Période pré-ictérique : dure 3 à 15 jours et se caractérise par des symptômes d'intoxication (fièvre, faiblesse générale, léthargie, apathie, irritabilité, troubles du sommeil, perte d'appétit), arthralgie, douleur dans l'hypocondre droit. Dans certains cas, une éruption cutanée est observée. Au cours des 1 à 2 derniers jours des règles, les selles se décolorent et l'urine s'assombrit. La période ictérique dure de 10 à 14 à 30 à 40 jours. La coloration de la jaunisse apparaît pour la première fois
Clinique de l'hépatite virale aiguë B (AVHB) La durée de la période d'incubation est de 30 à 180 jours (généralement 2-3 mois). Période pré-ictérique : dure 3 à 15 jours et se caractérise par des symptômes d'intoxication (fièvre, faiblesse générale, léthargie, apathie, irritabilité, troubles du sommeil, perte d'appétit), arthralgie, douleur dans l'hypocondre droit. Dans certains cas, une éruption cutanée est observée. Au cours des 1 à 2 derniers jours des règles, les selles se décolorent et l'urine s'assombrit. La période ictérique dure de 10 à 14 à 30 à 40 jours. La coloration de la jaunisse apparaît pour la première fois
Diapositive 26
 sur les muqueuses, puis sur la peau. Les symptômes d'intoxication s'intensifient généralement après l'apparition de la jaunisse. Le foie et la rate (dans 30 à 50 % des cas) sont hypertrophiés. Une bradycardie apparaît, la tension artérielle diminue et les bruits cardiaques s'affaiblissent. Dans les formes sévères, une dépression du système nerveux central de gravité variable, des syndromes dyspeptiques et hémorragiques se développent. On distingue une forme maligne fulminante distincte, provoquée par une nécrose massive des hépatocytes avec développement d'une insuffisance rénale aiguë. La période de convalescence commence après la disparition de l'ictère et se termine après la résolution clinique et biologique complète de la maladie, qui survient généralement 3 mois après son apparition.
sur les muqueuses, puis sur la peau. Les symptômes d'intoxication s'intensifient généralement après l'apparition de la jaunisse. Le foie et la rate (dans 30 à 50 % des cas) sont hypertrophiés. Une bradycardie apparaît, la tension artérielle diminue et les bruits cardiaques s'affaiblissent. Dans les formes sévères, une dépression du système nerveux central de gravité variable, des syndromes dyspeptiques et hémorragiques se développent. On distingue une forme maligne fulminante distincte, provoquée par une nécrose massive des hépatocytes avec développement d'une insuffisance rénale aiguë. La période de convalescence commence après la disparition de l'ictère et se termine après la résolution clinique et biologique complète de la maladie, qui survient généralement 3 mois après son apparition.
Diapositive 27
 Hépatite virale C L'hépatite C est la forme la plus courante de maladie hépatique chronique dans la plupart des pays européens et en Amérique du Nord. Selon l’OMS, il y a au moins 170 millions de personnes infectées par le VHC dans le monde.
Hépatite virale C L'hépatite C est la forme la plus courante de maladie hépatique chronique dans la plupart des pays européens et en Amérique du Nord. Selon l’OMS, il y a au moins 170 millions de personnes infectées par le VHC dans le monde.
Diapositive 28
 Étiologie L'agent causal de l'infection par le VHC est un virus à ARN de la famille des Flaviviridae. Le génome du virus est formé d’ARN simple brin. Le VHC est génétiquement hétérogène : il existe 6 génotopes principaux (1 à 6) et au moins 50 sous-types.
Étiologie L'agent causal de l'infection par le VHC est un virus à ARN de la famille des Flaviviridae. Le génome du virus est formé d’ARN simple brin. Le VHC est génétiquement hétérogène : il existe 6 génotopes principaux (1 à 6) et au moins 50 sous-types.
Diapositive 29

Diapositive 30
 Épidémiologie Selon l'OMS, il y a au moins 170 millions de personnes infectées par le VHC dans le monde. La prévalence de l'infection par le VHC varie également considérablement selon les régions, se situant en moyenne entre 0,5 et 2 % (jusqu'à 6,5 % dans les pays d'Afrique tropicale). L'infection par le VHC est à l'origine d'environ 40 % des cas de pathologie hépatique chronique. Le nombre total de personnes infectées par le VHC en Russie est de 1 million 700 000 personnes.
Épidémiologie Selon l'OMS, il y a au moins 170 millions de personnes infectées par le VHC dans le monde. La prévalence de l'infection par le VHC varie également considérablement selon les régions, se situant en moyenne entre 0,5 et 2 % (jusqu'à 6,5 % dans les pays d'Afrique tropicale). L'infection par le VHC est à l'origine d'environ 40 % des cas de pathologie hépatique chronique. Le nombre total de personnes infectées par le VHC en Russie est de 1 million 700 000 personnes.
Diapositive 31
 Pathogenèse Le virus pénètre dans l'organisme de la même manière que le virus de l'hépatite B, bien qu'il puisse également pénétrer à travers la peau intacte. Ayant un tropisme pour les hépatocytes, le virus a sur ceux-ci un effet cytopathique direct. En raison de l’hétérogénéité génétique du virus de l’hépatite C, celui-ci présente de nombreuses variantes antigéniques, ce qui rend difficile la mise en œuvre d’une réponse immunitaire adéquate. Les particules virales pénètrent dans les cellules du système macrophage du corps et provoquent une certaine réaction de leur part, visant à éliminer le virus.
Pathogenèse Le virus pénètre dans l'organisme de la même manière que le virus de l'hépatite B, bien qu'il puisse également pénétrer à travers la peau intacte. Ayant un tropisme pour les hépatocytes, le virus a sur ceux-ci un effet cytopathique direct. En raison de l’hétérogénéité génétique du virus de l’hépatite C, celui-ci présente de nombreuses variantes antigéniques, ce qui rend difficile la mise en œuvre d’une réponse immunitaire adéquate. Les particules virales pénètrent dans les cellules du système macrophage du corps et provoquent une certaine réaction de leur part, visant à éliminer le virus.
Diapositive 32
 En raison du fait que la composition antigénique de la particule virale est similaire à la composition antigénique des hépatocytes et qu'à la surface des hépatocytes se trouvent également des fragments de particules virales synthétisées sur l'ARN viral pour un assemblage ultérieur dans le virus, il existe un mécanisme auto-immun. de dommages aux hépatocytes. De plus, on ne peut exclure un effet mutagène direct du virus de l'hépatite C sur les macrophages, modifiant leurs propriétés de telle sorte qu'ils deviennent capables de réagir avec les antigènes d'histocompatibilité du système HLA et de provoquer ainsi une réaction auto-immune.
En raison du fait que la composition antigénique de la particule virale est similaire à la composition antigénique des hépatocytes et qu'à la surface des hépatocytes se trouvent également des fragments de particules virales synthétisées sur l'ARN viral pour un assemblage ultérieur dans le virus, il existe un mécanisme auto-immun. de dommages aux hépatocytes. De plus, on ne peut exclure un effet mutagène direct du virus de l'hépatite C sur les macrophages, modifiant leurs propriétés de telle sorte qu'ils deviennent capables de réagir avec les antigènes d'histocompatibilité du système HLA et de provoquer ainsi une réaction auto-immune.
Diapositive 33

Diapositive 34
 Clinique de l'hépatite virale aiguë C (AVHC) La durée de la période d'incubation est de 20 à 90 jours. L'AVGS est généralement bénigne, principalement sous forme anictérique ou subclinique. Son diagnostic est relativement rare. Les symptômes les plus courants sont l'anorexie, les nausées, les vomissements, l'inconfort de l'hypocondre droit et parfois la jaunisse. Le risque de chronicité est présent chez plus de 80 % des patients.
Clinique de l'hépatite virale aiguë C (AVHC) La durée de la période d'incubation est de 20 à 90 jours. L'AVGS est généralement bénigne, principalement sous forme anictérique ou subclinique. Son diagnostic est relativement rare. Les symptômes les plus courants sont l'anorexie, les nausées, les vomissements, l'inconfort de l'hypocondre droit et parfois la jaunisse. Le risque de chronicité est présent chez plus de 80 % des patients.
Diapositive 35
 Hépatite virale D L'hépatite D (hépatite delta) est une infection anthroponotique virale avec un mécanisme d'infection parentéral, caractérisée par des lésions inflammatoires du foie.
Hépatite virale D L'hépatite D (hépatite delta) est une infection anthroponotique virale avec un mécanisme d'infection parentéral, caractérisée par des lésions inflammatoires du foie.
Diapositive 36
 Étiologie La maladie est causée par un virus à ARN partiel (HDV, virus δ), dont l'expression nécessite un VHB dont la taille du génome est de 19 nm. Appartient à la famille des Deltavirus.
Étiologie La maladie est causée par un virus à ARN partiel (HDV, virus δ), dont l'expression nécessite un VHB dont la taille du génome est de 19 nm. Appartient à la famille des Deltavirus.
Diapositive 37

Diapositive 38
 Épidémiologie La voie de transmission est similaire à celle de l'infection par le VHB. L’infection par le HDV est plus courante en Europe du Sud, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Amérique centrale et du Sud. Il y a environ 15 millions de personnes atteintes d’hépatite D dans le monde.
Épidémiologie La voie de transmission est similaire à celle de l'infection par le VHB. L’infection par le HDV est plus courante en Europe du Sud, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Amérique centrale et du Sud. Il y a environ 15 millions de personnes atteintes d’hépatite D dans le monde.
Diapositive 39
 Pathogenèse Les mécanismes des lésions des tissus hépatiques causées par le HDV (virus de l'hépatite D) et l'hépatite D sous-jacente ne sont pas clairs. On pense que les lésions hépatiques sont largement associées à la réponse immunitaire à l’infection par le HDV (virus de l’hépatite D). Très probablement, cela est dû à l'interaction de facteurs tels que le génotype du HDV (virus de l'hépatite D), le système immunitaire du patient et les caractéristiques du VHB (virus de l'hépatite B) (génotype et activité de réplication).
Pathogenèse Les mécanismes des lésions des tissus hépatiques causées par le HDV (virus de l'hépatite D) et l'hépatite D sous-jacente ne sont pas clairs. On pense que les lésions hépatiques sont largement associées à la réponse immunitaire à l’infection par le HDV (virus de l’hépatite D). Très probablement, cela est dû à l'interaction de facteurs tels que le génotype du HDV (virus de l'hépatite D), le système immunitaire du patient et les caractéristiques du VHB (virus de l'hépatite B) (génotype et activité de réplication).
Diapositive 40
 Clinique de l'hépatite virale aiguë D (AVHD) Les manifestations cliniques de la co-infection (infection simultanée par le VHB et le HDV) sont généralement identiques à celles de l'ARVHV. Les caractéristiques comprennent une période d'incubation plus courte, la présence d'une forte fièvre prolongée, l'apparition fréquente d'éruptions cutanées et des douleurs migrantes dans les grosses articulations. L'évolution est relativement favorable, le risque de chronicité n'est pas dépassé, comme pour le VHB.
Clinique de l'hépatite virale aiguë D (AVHD) Les manifestations cliniques de la co-infection (infection simultanée par le VHB et le HDV) sont généralement identiques à celles de l'ARVHV. Les caractéristiques comprennent une période d'incubation plus courte, la présence d'une forte fièvre prolongée, l'apparition fréquente d'éruptions cutanées et des douleurs migrantes dans les grosses articulations. L'évolution est relativement favorable, le risque de chronicité n'est pas dépassé, comme pour le VHB.
Diapositive 41
 Hépatite virale chronique Les manifestations cliniques de l'hépatite chronique sont assez polymorphes et comprennent un large éventail de symptômes. Le syndrome dyspeptique est associé à une violation de la fonction de détoxification du foie, à une pathologie concomitante du duodénum et du pancréas. Le syndrome asthénique (faiblesse, fatigue, diminution des performances, irritabilité) s'exprime plus ou moins chez les patients atteints d'hépatite chronique. Signes de lésions hépatiques :
Hépatite virale chronique Les manifestations cliniques de l'hépatite chronique sont assez polymorphes et comprennent un large éventail de symptômes. Le syndrome dyspeptique est associé à une violation de la fonction de détoxification du foie, à une pathologie concomitante du duodénum et du pancréas. Le syndrome asthénique (faiblesse, fatigue, diminution des performances, irritabilité) s'exprime plus ou moins chez les patients atteints d'hépatite chronique. Signes de lésions hépatiques :
Diapositive 42
 - avec un processus actif, une hypertrophie, un épaississement et une sensibilité du foie sont généralement détectés ; - un ictère (parenchymateux) est observé relativement rarement ; - les télangiectasies et l'érythème palmaire sont provoqués par une augmentation de la concentration d'œstrogènes et une modification de la sensibilité des récepteurs vasculaires. Leur gravité est en corrélation avec l'activité du processus et n'indique pas toujours une cirrhose du foie. - hypertension portale (ascite, splénomégalie, varices œsophagiennes) des signes d'insuffisance hépatique apparaissent et progressent. - L'aménorrhée, la gynécomastie, la diminution de la libido sont associées à une altération du métabolisme des hormones sexuelles dans le foie (généralement au stade de la cirrhose).
- avec un processus actif, une hypertrophie, un épaississement et une sensibilité du foie sont généralement détectés ; - un ictère (parenchymateux) est observé relativement rarement ; - les télangiectasies et l'érythème palmaire sont provoqués par une augmentation de la concentration d'œstrogènes et une modification de la sensibilité des récepteurs vasculaires. Leur gravité est en corrélation avec l'activité du processus et n'indique pas toujours une cirrhose du foie. - hypertension portale (ascite, splénomégalie, varices œsophagiennes) des signes d'insuffisance hépatique apparaissent et progressent. - L'aménorrhée, la gynécomastie, la diminution de la libido sont associées à une altération du métabolisme des hormones sexuelles dans le foie (généralement au stade de la cirrhose).
Diapositive 43
 Les manifestations extrahépatiques du CHB se développent assez rarement et sont généralement représentées par des lésions rénales, une périartérite noueuse ou une cryoglobulinémie. Un peu plus souvent, des manifestations extrahépatiques se développent avec le CHC. Cryoglobulinémie possible, glomérulonéphrite membraneuse, porphyrie cutanée tardive, thyroïdite auto-immune, moins fréquemment - syndrome de Sjögren, lichen plan, arthrite séronégative, anémie aplasique, lymphome à cellules B.
Les manifestations extrahépatiques du CHB se développent assez rarement et sont généralement représentées par des lésions rénales, une périartérite noueuse ou une cryoglobulinémie. Un peu plus souvent, des manifestations extrahépatiques se développent avec le CHC. Cryoglobulinémie possible, glomérulonéphrite membraneuse, porphyrie cutanée tardive, thyroïdite auto-immune, moins fréquemment - syndrome de Sjögren, lichen plan, arthrite séronégative, anémie aplasique, lymphome à cellules B.
Diapositive 44
 Tests de laboratoire Méthodes d'examen obligatoires : Test sanguin clinique : augmentation possible de la VS, leucopénie, lymphocytose, sous forme fulminante d'OVH - leucocytose. Analyse générale des urines : avec CVH et exacerbation de CVH, l'apparition de pigments biliaires (principalement bilirubine directe) et d'urobiline est possible. Chimie sanguine:
Tests de laboratoire Méthodes d'examen obligatoires : Test sanguin clinique : augmentation possible de la VS, leucopénie, lymphocytose, sous forme fulminante d'OVH - leucocytose. Analyse générale des urines : avec CVH et exacerbation de CVH, l'apparition de pigments biliaires (principalement bilirubine directe) et d'urobiline est possible. Chimie sanguine:
Diapositive 45
 - syndrome de cytolyse : augmentation des taux d'ALT, AST ; - syndrome de cholestase : augmentation des taux de bilirubine totale, de cholestérol, de phosphatase alcaline, de γ-glutamyl transpeptidase, généralement observée en cas d'ictère ; - syndrome d'inflammation mésenchymateuse : augmentation de la teneur en immunoglobulines, augmentation du test au thymol, diminution du test au sublimé ; - syndrome d'insuffisance hépatocellulaire : diminution de l'indice de prothrombine, de la concentration sérique d'albumine, du cholestérol, de la bilirubine totale : détecté dans les formes sévères d'hépatite chronique.
- syndrome de cytolyse : augmentation des taux d'ALT, AST ; - syndrome de cholestase : augmentation des taux de bilirubine totale, de cholestérol, de phosphatase alcaline, de γ-glutamyl transpeptidase, généralement observée en cas d'ictère ; - syndrome d'inflammation mésenchymateuse : augmentation de la teneur en immunoglobulines, augmentation du test au thymol, diminution du test au sublimé ; - syndrome d'insuffisance hépatocellulaire : diminution de l'indice de prothrombine, de la concentration sérique d'albumine, du cholestérol, de la bilirubine totale : détecté dans les formes sévères d'hépatite chronique.
Diapositive 46
 Marqueurs des virus de l'hépatite : Virus de l'hépatite B : L'AgHBs est détecté 1 à 10 semaines après l'infection, son apparition précède le développement de symptômes cliniques et une augmentation de l'activité ALT/AST. Avec une réponse immunitaire adéquate, elle disparaît 4 à 6 mois après l'infection par l'AgHBe, indiquant la réplication du virus dans les hépatocytes ; trouvé dans le sérum presque simultanément avec l'AgHBs ; L'anti-HBe (Ab à e-Ag) en combinaison avec les IgG anti-HBc et les anti-HBs indique l'achèvement complet du processus infectieux.
Marqueurs des virus de l'hépatite : Virus de l'hépatite B : L'AgHBs est détecté 1 à 10 semaines après l'infection, son apparition précède le développement de symptômes cliniques et une augmentation de l'activité ALT/AST. Avec une réponse immunitaire adéquate, elle disparaît 4 à 6 mois après l'infection par l'AgHBe, indiquant la réplication du virus dans les hépatocytes ; trouvé dans le sérum presque simultanément avec l'AgHBs ; L'anti-HBe (Ab à e-Ag) en combinaison avec les IgG anti-HBc et les anti-HBs indique l'achèvement complet du processus infectieux.
Diapositive 47
 L’anti-HBc (Ab to Nuclear Ag) est un marqueur diagnostique important de l’infection. Les IgM anti-HBc sont l’un des premiers marqueurs sériques du CHBV et un marqueur sensible de l’infection par le VHB. Indique la réplication du virus et l'activité du processus dans le foie ; sa disparition sert d'indicateur soit de l'assainissement du corps de l'agent pathogène, soit du développement de la phase intégrative de l'infection par le VHB. Les IgG anti-HBc persistent pendant de nombreuses années ; indiquer une infection existante ou antérieure. L'ADN du VHB et l'ADN polymérase sont des marqueurs diagnostiques de la réplication du virus.
L’anti-HBc (Ab to Nuclear Ag) est un marqueur diagnostique important de l’infection. Les IgM anti-HBc sont l’un des premiers marqueurs sériques du CHBV et un marqueur sensible de l’infection par le VHB. Indique la réplication du virus et l'activité du processus dans le foie ; sa disparition sert d'indicateur soit de l'assainissement du corps de l'agent pathogène, soit du développement de la phase intégrative de l'infection par le VHB. Les IgG anti-HBc persistent pendant de nombreuses années ; indiquer une infection existante ou antérieure. L'ADN du VHB et l'ADN polymérase sont des marqueurs diagnostiques de la réplication du virus.
Des centaines de fournisseurs apportent des médicaments contre l'hépatite C d'Inde en Russie, mais seul M-PHARMA vous aidera à acheter du sofosbuvir et du daclatasvir, et des consultants professionnels répondront à toutes vos questions tout au long du traitement.
L'hépatite est le nom donné aux maladies inflammatoires aiguës et chroniques du foie qui ne sont pas focales mais répandues. Différentes hépatites ont différentes méthodes d'infection ; elles diffèrent également par le taux de progression de la maladie, les manifestations cliniques, les méthodes et le pronostic du traitement. Même les symptômes des différents types d’hépatite sont différents. De plus, certains symptômes sont plus forts que d’autres, ce qui est déterminé par le type d’hépatite.Principaux symptômes
- Jaunisse. Le symptôme est fréquent et est dû au fait que la bilirubine pénètre dans le sang du patient lorsque le foie est endommagé. Le sang, circulant dans tout le corps, le transporte vers les organes et les tissus, les colorant en jaune.
- L'apparition de douleurs dans la région de l'hypocondre droit. Elle survient en raison d'une augmentation de la taille du foie, entraînant des douleurs qui peuvent être sourdes et prolongées ou de nature paroxystique.
- Détérioration de la santé, accompagnée de fièvre, maux de tête, vertiges, indigestion, somnolence et léthargie. Tout cela est une conséquence de l'effet de la bilirubine sur le corps.
Hépatite aiguë et chronique
L'hépatite chez les patients a des formes aiguës et chroniques. Sous forme aiguë, ils apparaissent en cas de lésions virales du foie, ainsi qu'en cas d'intoxication par divers types de poisons. Dans les formes aiguës de la maladie, l'état des patients se détériore rapidement, ce qui contribue au développement accéléré des symptômes.
Avec cette forme de la maladie, un pronostic favorable est tout à fait possible. Sauf sa transformation en chronique. Dans sa forme aiguë, la maladie est facilement diagnostiquée et plus facile à traiter. L'hépatite aiguë non traitée évolue facilement vers une forme chronique. Parfois, en cas d'intoxication grave (par exemple, alcool), la forme chronique survient indépendamment. Dans la forme chronique de l'hépatite, le processus de remplacement des cellules hépatiques par du tissu conjonctif se produit. Elle est faiblement exprimée, progresse lentement et reste donc parfois non diagnostiquée jusqu'à l'apparition d'une cirrhose du foie. L'hépatite chronique est moins traitable et le pronostic de sa guérison est moins favorable. Au cours de l'évolution aiguë de la maladie, la santé se détériore considérablement, une jaunisse se développe, une intoxication apparaît, le fonctionnement fonctionnel du foie diminue et la teneur en bilirubine dans le sang augmente. Avec une détection rapide et un traitement efficace de l'hépatite aiguë, le patient se rétablit le plus souvent. Lorsque la maladie dure plus de six mois, l’hépatite devient chronique. La forme chronique de la maladie entraîne de graves troubles du corps - la rate et le foie grossissent, le métabolisme est perturbé, des complications surviennent sous forme de cirrhose du foie et de cancer. Si le patient a une immunité réduite, si le schéma thérapeutique est mal choisi ou s'il existe une dépendance à l'alcool, la transition de l'hépatite vers une forme chronique menace la vie du patient.
Types d'hépatite
L'hépatite a plusieurs types : A, B, C, D, E, F, G, elles sont aussi appelées hépatites virales, car elles sont causées par un virus.Hépatite A
Ce type d'hépatite est également appelé maladie de Botkin. Sa période d'incubation dure de 7 jours à 2 mois. Son agent causal, un virus à ARN, peut être transmis d'une personne malade à une personne en bonne santé par le biais d'aliments et d'eau de mauvaise qualité, ou par contact avec des articles ménagers utilisés par la personne malade. L'hépatite A est possible sous trois formes, elles se répartissent selon la gravité de la maladie :- dans la forme aiguë avec jaunisse, le foie est gravement endommagé ;
- avec une forme subaiguë sans jaunisse, on peut parler d'une version plus douce de la maladie ;
- sous forme subclinique, vous ne remarquerez peut-être même pas de symptômes, bien que la personne infectée soit la source du virus et soit capable d'en infecter d'autres.
Hépatite B
Cette maladie est également appelée hépatite sérique. Accompagné d'une hypertrophie du foie et de la rate, de douleurs articulaires, de vomissements, de fièvre et de lésions hépatiques. Elle survient sous des formes aiguës ou chroniques, qui sont déterminées par l’état de l’immunité du patient. Voies d'infection : lors d'injections en violation des règles sanitaires, de contacts sexuels, de transfusions sanguines et d'utilisation d'instruments médicaux mal désinfectés. La durée de la période d'incubation est de 50 ÷ 180 jours. L'incidence de l'hépatite B diminue avec la vaccination.Hépatite C
Ce type de maladie est l’une des maladies les plus graves, car elle s’accompagne souvent d’une cirrhose ou d’un cancer du foie, qui entraîne ensuite la mort. La maladie est difficile à traiter et, de plus, après avoir eu une fois l'hépatite C, une personne peut être à nouveau infectée par la même maladie. Il n'est pas facile de guérir le VHC : après avoir contracté l'hépatite C sous une forme aiguë, 20 % des patients guérissent, mais chez 70 % des patients, le corps n'est pas capable de se remettre du virus par lui-même et la maladie devient chronique. Il n’a pas encore été possible d’établir la raison pour laquelle certains guérissent d’eux-mêmes et d’autres non. La forme chronique de l'hépatite C ne disparaîtra pas d'elle-même et nécessite donc un traitement. Le diagnostic et le traitement de la forme aiguë du VHC sont effectués par un spécialiste des maladies infectieuses et la forme chronique de la maladie est effectuée par un hépatologue ou un gastro-entérologue. Vous pouvez être infecté lors d'une transfusion de plasma ou de sang provenant d'un donneur infecté, par l'utilisation d'instruments médicaux mal traités, par contact sexuel, et une mère malade transmet l'infection à son enfant. Le virus de l'hépatite C (VHC) se propage rapidement dans le monde ; le nombre de patients dépasse depuis longtemps les cent millions et demi de personnes. Auparavant, le VHC était difficile à traiter, mais il est désormais possible de guérir la maladie grâce aux antiviraux modernes à action directe. Mais cette thérapie est assez coûteuse et tout le monde ne peut donc pas se le permettre.Hépatite D
Ce type d'hépatite D n'est possible qu'en cas de co-infection avec le virus de l'hépatite B (la co-infection est le cas de l'infection d'une cellule par des virus de différents types). Elle s'accompagne de lésions hépatiques massives et d'une évolution aiguë de la maladie. La voie d'infection est l'entrée du virus de la maladie dans le sang d'une personne en bonne santé provenant d'un porteur du virus ou d'une personne malade. La période d'incubation dure 20 ÷ 50 jours. Extérieurement, l'évolution de la maladie ressemble à l'hépatite B, mais sa forme est plus grave. Elle peut devenir chronique, puis se transformer en cirrhose. Il est possible de réaliser une vaccination similaire à celle utilisée pour l'hépatite B.Hépatite E
Elle rappelle légèrement l’hépatite A dans son évolution et son mécanisme de transmission, puisqu’elle se transmet également par le sang. Sa particularité est l'apparition de formes ultra-rapides qui entraînent la mort dans un délai n'excédant pas 10 jours. Dans d’autres cas, elle peut être guérie efficacement et le pronostic de guérison est le plus souvent favorable. Une exception peut être la grossesse, puisque le risque de perdre un enfant est proche de 100 %.Hépatite F
Ce type d'hépatite n'a pas encore été suffisamment étudié. On sait seulement que la maladie est causée par deux virus différents : l'un a été isolé du sang de donneurs, le second a été trouvé dans les selles d'un patient ayant contracté l'hépatite après une transfusion sanguine. Signes : apparition d'un ictère, de fièvre, d'ascite (accumulation de liquide dans la cavité abdominale), augmentation de la taille du foie et de la rate, augmentation des taux de bilirubine et d'enzymes hépatiques, apparition de modifications des urines et des selles, ainsi qu'une intoxication générale du corps. Des méthodes efficaces de traitement de l’hépatite F n’ont pas encore été développées.Hépatite G
Ce type d'hépatite est similaire à l'hépatite C, mais n'est pas aussi dangereux car il ne contribue pas au développement de la cirrhose et du cancer du foie. La cirrhose ne peut apparaître qu'en cas de co-infection avec les hépatites G et C.Diagnostique
L’hépatite virale présente des symptômes similaires, tout comme certaines autres infections virales. Pour cette raison, il peut être difficile de diagnostiquer avec précision une personne malade. En conséquence, pour clarifier le type d'hépatite et la prescription correcte du traitement, des analyses de sang en laboratoire sont nécessaires pour identifier des marqueurs - indicateurs individuels pour chaque type de virus. En identifiant la présence de tels marqueurs et leur ratio, il est possible de déterminer le stade de la maladie, son activité et son issue possible. Afin de suivre la dynamique du processus, les examens sont répétés après un certain temps.Comment traite-t-on l’hépatite C ?
Les schémas thérapeutiques modernes pour les formes chroniques du VHC se résument à une thérapie antivirale combinée, comprenant des antiviraux à action directe tels que le sofosbuvir, le velpatasvir, le daclatasvir et le lédipasvir dans diverses combinaisons. Parfois, de la ribavirine et des interférons sont ajoutés pour améliorer l'efficacité. Cette combinaison de principes actifs arrête la réplication des virus, sauvant ainsi le foie de leurs effets destructeurs. Ce type de thérapie présente un certain nombre d'inconvénients :- Le coût des médicaments contre le virus de l’hépatite est élevé et tout le monde ne peut pas les acheter.
- La prise de certains médicaments s'accompagne d'effets secondaires désagréables, notamment de la fièvre, des nausées et de la diarrhée.
Caractéristiques des génotypes du VHC
L'hépatite C est l'une des hépatites virales les plus dangereuses. La maladie est causée par un virus à ARN appelé Flaviviridae. Le virus de l’hépatite C est également appelé le « tueur doux ». Il a reçu une épithète si peu flatteuse en raison du fait qu'au stade initial, la maladie ne s'accompagne d'aucun symptôme. Il n'y a aucun signe d'ictère classique et il n'y a aucune douleur dans la région de l'hypocondre droit. La présence du virus peut être détectée au plus tôt quelques mois après l'infection. Avant cela, la réaction du système immunitaire est totalement absente et les marqueurs ne peuvent pas être détectés dans le sang, ce qui rend le génotypage impossible. Une autre caractéristique du VHC est qu’après avoir pénétré dans la circulation sanguine pendant le processus de reproduction, le virus commence à muter rapidement. De telles mutations empêchent le système immunitaire de la personne infectée de s’adapter et de combattre la maladie. En conséquence, la maladie peut durer plusieurs années sans aucun symptôme, après quoi une cirrhose ou une tumeur maligne apparaît presque immédiatement. De plus, dans 85 % des cas, la maladie passe d'une forme aiguë à une forme chronique. Le virus de l'hépatite C présente une caractéristique importante : une structure génétique variée. En fait, l’hépatite C est un ensemble de virus, classés en fonction de leurs variantes structurelles et divisés en génotypes et sous-types. Le génotype est la somme des gènes codant pour des caractères héréditaires. Jusqu'à présent, la médecine connaît 11 génotypes du virus de l'hépatite C, qui ont leurs propres sous-types. Le génotype est désigné par des chiffres de 1 à 11 (bien que les génotypes 1 ÷ 6 soient principalement utilisés dans les études cliniques), et les sous-types sont désignés par des lettres de l'alphabet latin :- 1a, 1b et 1c ;
- 2a, 2b, 2c et 2d ;
- 3a, 3b, 3c, 3d, 3e et 3f ;
- 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4h, 4i et 4j ;
Comment les souches du VHC sont-elles réparties sur la planète ?
Les génotypes de l'hépatite C sont répartis de manière hétérogène à travers le monde, et les génotypes 1, 2, 3 peuvent être trouvés le plus souvent, et dans certaines régions, cela ressemble à ceci :
- en Europe occidentale et dans ses régions orientales, les génotypes 1 et 2 sont les plus courants ;
- aux États-Unis - sous-types 1a et 1b ;
- en Afrique du Nord, le génotype 4 est le plus répandu.
- le génotype 1b représente environ 50 % des cas ;
- pour le génotype 3a ~20%,
- ~ 10 % des patients sont infectés par l’hépatite 1a ;
- une hépatite de génotype 2 a été trouvée chez environ 5 % des personnes infectées.
- âge des patients. Les chances de guérison sont bien plus élevées chez les jeunes ;
- Il est plus facile pour les femmes de se rétablir que pour les hommes ;
- le degré de lésion hépatique est important - l'issue favorable est plus élevée avec moins de dégâts ;
- l'ampleur de la charge virale - moins il y a de virus dans le corps au moment du traitement, plus la thérapie est efficace ;
- le poids du patient : plus il est élevé, plus le traitement devient compliqué.
Qui est à risque d’être infecté par le VHC ?
Comme vous le savez, le virus de l'hépatite C se transmet par le sang et les personnes suivantes sont donc les plus susceptibles d'être infectées :- les patients recevant des transfusions sanguines ;
- les patients et les clients des cabinets dentaires et des établissements médicaux où les instruments médicaux sont mal stérilisés ;
- visiter les salons de manucure et de beauté peut être dangereux en raison d'instruments non stériles ;
- les amateurs de piercing et de tatouage peuvent également souffrir d'outils mal traités,
- il existe un risque élevé d'infection pour ceux qui consomment des drogues en raison de l'utilisation répétée d'aiguilles non stériles ;
- le fœtus peut être infecté par une mère infectée par l'hépatite C ;
- Lors d’un rapport sexuel, l’infection peut également pénétrer dans le corps d’une personne en bonne santé.
Comment traite-t-on l’hépatite C ?
Ce n’est pas pour rien que le virus de l’hépatite C était considéré comme un virus mortel « doux ». Elle peut rester silencieuse pendant des années, puis apparaître soudainement sous forme de complications accompagnées d'une cirrhose ou d'un cancer du foie. Mais plus de 177 millions de personnes dans le monde ont reçu un diagnostic de VHC. Le traitement utilisé jusqu'en 2013, associant des injections d'interféron et de ribavirine, donnait aux patients des chances de guérison qui ne dépassaient pas 40 à 50 %. De plus, cela s’accompagnait d’effets secondaires graves et douloureux. La situation a changé à l'été 2013 après que le géant pharmaceutique américain Gilead Sciences a breveté la substance sofosbuvir, produite sous la forme d'un médicament sous la marque Sovaldi, qui contenait 400 mg de médicament. Il s’agit du premier médicament antiviral à action directe (AAD) destiné à combattre le VHC. Les résultats des essais cliniques sur le sofosbuvir ont satisfait les médecins par son efficacité, qui a atteint 85 ÷ 95 % selon le génotype, tandis que la durée du traitement a été réduite de plus de moitié par rapport au traitement par interférons et ribavirine. Et bien que la société pharmaceutique Gilead ait breveté le sofosbuvir, celui-ci a été synthétisé en 2007 par Michael Sophia, un employé de Pharmasett, qui a ensuite été racheté par Gilead Sciences. Du nom de famille de Michael, la substance qu’il a synthétisée s’appelle sofosbuvir. Michael Sofia lui-même, ainsi qu'un groupe de scientifiques qui ont fait un certain nombre de découvertes révélant la nature du VHC, permettant de créer un médicament efficace pour son traitement, ont reçu le prix Lasker-DeBakey pour la recherche médicale clinique. Eh bien, presque tous les bénéfices de la vente du nouveau produit efficace sont allés à Gilead, qui a fixé des prix monopolistiques élevés pour Sovaldi. De plus, l'entreprise a protégé son développement par un brevet spécial, selon lequel Gilead et certaines de ses sociétés partenaires sont devenues propriétaires du droit exclusif de fabriquer le DPP original. En conséquence, les bénéfices de Gilead au cours des deux premières années de vente du médicament ont largement couvert tous les coûts engagés par la société pour acquérir Pharmasett, obtenir un brevet et mener des essais cliniques ultérieurs.Qu’est-ce que le Sofosbuvir ?
L'efficacité de ce médicament dans la lutte contre le VHC s'est avérée si élevée que pratiquement aucun schéma thérapeutique ne peut désormais se passer de son utilisation. Le sofosbuvir n’est pas recommandé en monothérapie, mais lorsqu’il est utilisé en association, il donne des résultats exceptionnellement bons. Initialement, le médicament était utilisé en association avec la ribavirine et l'interféron, ce qui permettait de guérir en seulement 12 semaines dans des cas simples. Et ce malgré le fait que le traitement par interféron et ribavirine seuls était deux fois moins efficace et que sa durée dépassait parfois 40 semaines. Après 2013, chaque année suivante a apporté l’actualité de l’émergence de plus en plus de nouveaux médicaments qui combattent avec succès le virus de l’hépatite C :
- le daclatasvir est apparu en 2014 ;
- 2015 a été l’année de naissance du lédipasvir ;
- 2016 satisfait de la création du velpatasvir.
- Harvoni, associant sofosbuvir 400 mg et lédipasvir 90 mg ;
- Epclusa, qui comprenait 400 mg de sofosbuvir et 100 mg de velpatasvir.
L’émergence des génériques
Les essais cliniques ont confirmé l'efficacité du traitement, mais tous ces médicaments très efficaces présentaient un inconvénient majeur : des prix trop élevés, qui empêchaient la majorité des patients de les acheter. Les prix élevés du monopole pour les produits fixés par Gilead ont provoqué l'indignation et les scandales, qui ont contraint les titulaires de brevets à faire certaines concessions, accordant à certaines entreprises d'Inde, d'Égypte et du Pakistan des licences pour produire des analogues (génériques) de médicaments aussi efficaces et populaires. De plus, la lutte contre les détenteurs de brevets proposant des médicaments à des prix biaisés a été menée par l’Inde, pays où vivent des millions de patients atteints d’hépatite C chronique. À la suite de cette lutte, Gilead a délivré des licences et des brevets à 11 sociétés indiennes pour qu'elles produisent de manière indépendante d'abord le sofosbuvir, puis ses autres nouveaux médicaments. Ayant obtenu des licences, les fabricants indiens ont rapidement commencé à produire des génériques, attribuant leur propre nom commercial aux médicaments qu'ils produisaient. C'est ainsi qu'apparaissent les génériques Sovaldi, puis Daklinza, Harvoni, Epclusa et l'Inde deviennent le leader mondial de leur production. Les fabricants indiens, dans le cadre d'un accord de licence, versent 7 % de leurs revenus aux titulaires de brevets. Mais même avec ces paiements, le coût des génériques produits en Inde s’est avéré dix fois inférieur à celui des originaux.Mécanismes d'action
Comme indiqué ci-dessus, les nouveaux produits thérapeutiques contre le VHC qui ont fait leur apparition sont classés comme AAD et agissent directement sur le virus. Alors que l'interféron et la ribavirine, auparavant utilisés à des fins thérapeutiques, renforçaient le système immunitaire humain, aidant ainsi l'organisme à résister à la maladie. Chaque substance agit sur le virus à sa manière :- Le sofosbuvir bloque l'ARN polymérase, inhibant ainsi la réplication virale.
- Le daclatasvir, le lédipasvir et le velpatasvir sont des inhibiteurs de la NS5A qui interfèrent avec la propagation des virus et leur entrée dans les cellules saines.
Fabricants de génériques indiens
Les sociétés pharmaceutiques du pays ont profité des licences qui leur ont été accordées et l'Inde produit désormais le Sovaldi générique suivant :- Hepcvir - fabriqué par Cipla Ltd. ;
- Hepcinat - Natco Pharma Ltée;
- Cimivir - Biocon ltée. & Hétéro Drugs Ltd.;
- MyHep est fabriqué par Mylan Pharmaceuticals Private Ltd. ;
- SoviHep - Zydus Heptiza Ltd.;
- Sofovir - fabriqué par Hetero Drugs Ltd. ;
- Resof - produit par les Laboratoires du Dr Reddy ;
- Virso - produit par Strides Arcolab.
- Natdac de Natco Pharma ;
- Dacihep de Zydus Heptiza ;
- Daclahep de Hetero Drugs ;
- Dactovin de Strides Arcolab ;
- Dalawin de Biocon ltd. & Hétéro Drugs Ltd.;
- Mydacla de Mylan Pharmaceuticals.
- Ledifos - publié par Hetero ;
- Hepcinat LP - Natco;
- Myhep LVIR - Mylan ;
- Hepcvir L - Cipla Ltd.;
- Cimivir L - Biocon ltée. & Hétéro Drugs Ltd.;
- LadyHep - Zydus.
- Velpanat a été commercialisé par la société pharmaceutique Natco Pharma ;
- la sortie de Velasof a été maîtrisée par Hetero Drugs ;
- SoviHep V a été lancé par Zydus Heptiza.
Exigences pour les génériques
Un générique est un médicament qui, sur la base de ses propriétés pharmacologiques fondamentales, peut remplacer un traitement par des médicaments originaux coûteux et brevetés. Ils peuvent être produits avec ou sans licence ; seule leur présence confère une licence à l'analogue produit. Dans le cas de l'octroi d'une licence aux sociétés pharmaceutiques indiennes, Gilead leur a également fourni la technologie de production, donnant ainsi aux titulaires de licence le droit à une politique de prix indépendante. Pour qu’un analogue médicamenteux soit considéré comme un générique, il doit répondre à un certain nombre de paramètres :- Il est nécessaire de respecter le rapport des composants pharmaceutiques les plus importants du médicament selon des normes qualitatives et quantitatives.
- Le respect des normes internationales pertinentes doit être respecté.
- Des conditions de production appropriées sont nécessaires.
- Les préparations doivent conserver les paramètres d’absorption équivalents appropriés.
Génériques égyptiens du sofosbuvir
Contrairement à l'Inde, les sociétés pharmaceutiques égyptiennes ne sont pas devenues des leaders mondiaux dans la production de médicaments génériques contre l'hépatite C, même si elles maîtrisent également la production d'analogues du sofosbuvir. Certes, la plupart des analogues qu'ils produisent sont sans licence :- MPI Viropack produit le médicament Marcyrl Pharmaceutical Industries, l'un des tout premiers génériques égyptiens ;
- Hétérosofir, produit par Pharmed Healthcare. Est le seul générique sous licence en Egypte. Il y a un code caché sur l'emballage sous l'hologramme qui permet de vérifier l'originalité du médicament sur le site du fabricant, éliminant ainsi sa contrefaçon ;
- Grateziano, fabriqué par Pharco Pharmaceuticals ;
- Sofolanork produit par Vimeo ;
- Sofocivir, fabriqué par ZetaPhar.
Des génériques pour lutter contre l'hépatite du Bangladesh
Le Bangladesh est un autre pays produisant de grandes quantités de médicaments génériques anti-VHC. De plus, ce pays n'exige même pas de licence pour la production d'analogues de médicaments de marque, puisque jusqu'en 2030 ses sociétés pharmaceutiques sont autorisées à produire de tels médicaments sans disposer des documents de licence appropriés. La société pharmaceutique la plus connue et dotée des dernières technologies est Beacon Pharmaceuticals Ltd. La conception de sa capacité de production a été créée par des spécialistes européens et répond aux normes internationales. Beacon produit les génériques suivants pour le traitement du virus de l'hépatite C :- Soforal est une version générique du sofosbuvir, contenant 400 mg de substance active. Contrairement au conditionnement traditionnel en flacons de 28 pièces, Soforal est produit sous forme de plaquettes thermoformées de 8 comprimés dans une plaquette ;
- Daclavir est une version générique du daclatasvir, un comprimé du médicament contient 60 mg de substance active. Il est également produit sous forme de plaquettes thermoformées, mais chaque plaquette contient 10 comprimés ;
- Sofosvel est une version générique d'Epclusa, contenant 400 mg de sofosbuvir et 100 mg de velpatasvir. Un médicament pangénotypique (universel), efficace dans le traitement des génotypes du VHC 1 ÷ 6. Et dans ce cas, il n'y a pas de conditionnement habituel en flacons, les comprimés sont conditionnés en blisters de 6 pièces dans chaque plaque.
- Darvoni est un médicament complexe qui associe 400 mg de sofosbuvir et 60 mg de daclatasvir. S'il est nécessaire d'associer un traitement au sofosbuvir avec le daklatasvir, en utilisant des médicaments d'autres fabricants, vous devez prendre un comprimé de chaque type. Et Beacon les a combinés en une seule pilule. Darvoni est conditionné en plaquettes thermoformées de 6 comprimés dans une plaque et envoyé uniquement à l'exportation.
Natco Pharma Ltée.
La société pharmaceutique la plus populaire est Natco Pharma Ltd., dont les médicaments ont sauvé la vie de plusieurs dizaines de milliers de personnes atteintes d'hépatite C chronique. Elle maîtrise la production de presque toute la gamme de médicaments antiviraux à action directe, y compris le sofosbuvir et le daclatasvir. et ledipasvir avec le velpatasvir. Natco Pharma est apparue en 1981 à Hyderabad avec un capital initial de 3,3 millions de roupies, puis le nombre d'employés était de 20 personnes. Aujourd'hui, en Inde, 3 500 personnes travaillent dans cinq entreprises Natco, et il existe également des succursales dans d'autres pays. En plus des unités de production, l'entreprise dispose de laboratoires bien équipés qui lui permettent de développer des médicaments modernes. Parmi ses propres développements, il convient de noter les médicaments destinés à lutter contre le cancer. L'un des médicaments les plus connus dans ce domaine est le Veenat, produit depuis 2003 et utilisé contre la leucémie. Et la production de génériques pour le traitement du virus de l'hépatite C est un domaine d'activité prioritaire pour Natco.Hétéro Drugs Ltd.
Cette entreprise s'est fixé pour objectif de produire des génériques, en subordonnant son propre réseau d'installations de production, comprenant des usines avec des succursales et des bureaux avec des laboratoires. Le réseau de production d'Hetero est conçu pour produire des médicaments sous licences obtenues par l'entreprise. L'un de ses domaines d'activité concerne les médicaments qui aident à lutter contre les maladies virales graves, dont le traitement est devenu impossible pour de nombreux patients en raison du coût élevé des médicaments originaux. La licence acquise permet à Hetero de commencer rapidement à produire des génériques, qui sont ensuite vendus à un prix abordable pour les patients. La création d’Hetero Drugs remonte à 1993. Au cours des 24 dernières années, une douzaine d'usines et plusieurs dizaines d'unités de production ont vu le jour en Inde. La présence de ses propres laboratoires permet à l'entreprise de mener des travaux expérimentaux sur la synthèse de substances, qui ont contribué à l'expansion de la base de production et à l'exportation active de médicaments vers l'étranger.Zydus Heptiza
Zydus est une entreprise indienne qui s'est fixé comme objectif la création d'une société saine qui, selon ses propriétaires, sera suivie d'un changement positif dans la qualité de vie des personnes. L'objectif est noble et, pour l'atteindre, l'entreprise mène des activités éducatives actives qui touchent les couches les plus pauvres de la population du pays. Y compris grâce à la vaccination gratuite de la population contre l'hépatite B. Zidus occupe la quatrième place en termes de volumes de production sur le marché pharmaceutique indien. En outre, 16 de ses médicaments figuraient sur la liste des 300 médicaments les plus importants de l'industrie pharmaceutique indienne. Les produits Zydus ne sont pas seulement demandés sur le marché intérieur : ils peuvent être trouvés dans les pharmacies de 43 pays de notre planète. Et la gamme de médicaments produits dans 7 entreprises dépasse 850 médicaments. L'une de ses installations de production les plus puissantes est située dans l'État du Gujarat et est l'une des plus grandes non seulement en Inde, mais aussi en Asie.Thérapie anti-VHC 2017
Les schémas thérapeutiques de l'hépatite C pour chaque patient sont sélectionnés individuellement par le médecin. Pour sélectionner correctement, efficacement et en toute sécurité un régime, le médecin doit savoir :- génotype du virus ;
- durée de la maladie;
- degré de lésion hépatique;
- présence/absence de cirrhose, infection concomitante (par exemple, VIH ou autre hépatite), expérience négative d'un traitement antérieur.
- Schémas thérapeutiques possibles proposés par l'EASL en cas de monoinfection par l'hépatite C ou d'infection concomitante VIH+VHC chez les patients n'ayant pas de cirrhose et n'ayant pas été traités auparavant :
- pour traitement génotypes 1a et 1b peut être utilisé:
- pendant la thérapie génotype 2 utilisé sans ribavirine pendant 12 semaines :
- pendant le traitement génotype 3 sans utilisation de ribavirine pendant une période de traitement de 12 semaines, utilisez :
- pendant la thérapie génotype 4 Vous pouvez utiliser sans ribavirine pendant 12 semaines :
- L'EASL a recommandé les schémas thérapeutiques pour la mono-infection par l'hépatite C ou l'infection concomitante par le VIH/VHC chez les patients atteints de cirrhose compensée qui n'ont pas été traités auparavant :
- pour traitement génotypes 1a et 1b peut être utilisé:
- pendant la thérapie génotype 2 appliquer:
- pendant le traitement génotype 3 utiliser:
- pendant la thérapie génotype 4 appliquer les mêmes schémas que pour les génotypes 1a et 1b.
Traitement avec des médicaments modernes contre le VHC
Prenez des comprimés de médicaments antiviraux directs prescrits par un médecin par voie orale une fois par jour. Ils ne sont pas divisés en parties, ni mâchés, mais arrosés à l'eau claire. Il est préférable de le faire en même temps, afin de maintenir une concentration constante de substances actives dans le corps. Il n'est pas nécessaire de se lier au moment des repas, l'essentiel est de ne pas le faire l'estomac vide. Lorsque vous commencez à prendre des médicaments, faites attention à ce que vous ressentez, car c'est pendant cette période qu'il est plus facile de remarquer d'éventuels effets secondaires. Les AAD eux-mêmes n’en contiennent pas beaucoup, mais les médicaments prescrits en association en contiennent beaucoup moins. Le plus souvent, les effets secondaires apparaissent comme suit :- maux de tête;
- vomissements et vertiges;
- faiblesse générale;
- perte d'appétit;
- douleur articulaire;
- modifications des paramètres sanguins biochimiques, exprimées par de faibles taux d'hémoglobine, une diminution des plaquettes et des lymphocytes.
Contre-indications
Dans certains cas, la prise de DAA est exclue, cela s'applique à :- hypersensibilité individuelle des patients à certains ingrédients médicamenteux ;
- les patients de moins de 18 ans, car il n'existe pas de données précises sur leurs effets sur l'organisme ;
- les femmes portant un fœtus et allaitant des bébés ;
- Les femmes doivent utiliser des méthodes de contraception fiables pour éviter toute conception pendant le traitement. De plus, cette exigence s'applique également aux femmes dont les partenaires suivent également un traitement par DAA.
Stockage
Conservez les médicaments antiviraux à action directe dans des endroits inaccessibles aux enfants et à l’abri de la lumière directe du soleil. La température de stockage doit être comprise entre 15 ÷ 30ºС. Lorsque vous commencez à prendre des médicaments, vérifiez leurs dates de fabrication et de conservation indiquées sur l'emballage. Les médicaments périmés ne doivent pas être pris. Comment acheter des DAA pour les résidents de Russie Malheureusement, il ne sera pas possible de trouver des génériques indiens dans les pharmacies russes. La société pharmaceutique Gilead, après avoir accordé des licences pour produire des médicaments, a prudemment interdit leur exportation vers de nombreux pays. Y compris tous les pays européens. Ceux qui souhaitent acheter des génériques indiens économiques pour lutter contre l'hépatite C peuvent utiliser plusieurs options :- commandez-les dans les pharmacies en ligne russes et recevez la marchandise en quelques heures (ou jours) selon le lieu de livraison. De plus, dans la plupart des cas, même un paiement anticipé n'est pas requis ;
- commandez-les dans les magasins en ligne indiens avec livraison à domicile. Ici, vous aurez besoin d'un acompte en devise étrangère et le délai d'attente durera de trois semaines à un mois. De plus, il sera nécessaire de communiquer avec le vendeur en anglais ;
- allez en Inde et apportez la drogue vous-même. Cela prendra également du temps, sans compter la barrière de la langue, ainsi que la difficulté de vérifier l'originalité du produit acheté en pharmacie. À cela s’ajoute le problème de l’auto-exportation, qui nécessite un contenant thermique, un rapport médical et une ordonnance en anglais, ainsi qu’une copie du récépissé.